Gestion des mammifères marins dans la région canadienne du Pacifique - un cadre de gestion intégrative
Voir le document de sommaire : Sommaire : Gestion des mammifères marins dans la région canadienne du Pacifique - un cadre de gestion intégrative
Sur cette page:
- Introduction
- Gestion des mammifères marins : les rôles, les responsabilités et les partenaires
- Mesures de gestion en actions : objectifs, actions et programmes
- Annexes: autres ressources et outils
Introduction
But primordial de gestion
Pêches et Océans Canada (MPO) s’engage à travailler avec les groupes autochtones, d’autres niveaux du gouvernement, les intervenants et les communautés côtières pour protéger les populations de mammifères marins au bénéfice des générations actuelles et futures de Canadiens, et trouver un équilibre entre la conservation de la vie marine et une offre importante d’opportunités économiques.
Principal défi et but de ce cadre
L’objectif principal représente également un défi de gestion de taille : il s’agit de trouver un équilibre entre la conservation et la protection des mammifères marins et leur habitat et les opportunités d’une économie bleue florissante. Gérer ce défi implique de prendre des décisions complexes de concert avec un grand nombre de personnes partageant cet objectif. Ce cadre présente certains de nos principaux défis ainsi que les découvertes et les progrès que nous réalisons lorsque nous travaillons en collaboration pour atteindre notre objectif.
Le principal but de ce cadre de gestion intégrée est d’organiser maintenant et dans le futur des actions de gestion du milieu marin qui maintiendront le dynamisme des populations de mammifères marins en Colombie-Britannique. Ce cadre reflète également l’engagement de Pêches et Océans Canada à adopter une approche écosystémique qui prête attention à la complexité des écosystèmes et aux interconnexions entre leurs éléments constitutifs. En tant que tels, les outils du cadre visent à soutenir une approche adaptable et intégrative afin de permettre aux gestionnaires des systèmes de gestion environnementale de prendre en compte le rôle important que jouent les mammifères marins d’un point de vue biologique, géographique et fonctionnelle pour notre environnement marin dans son ensemble.
A propos de ce cadre - une approche intégrative de la gestion des mammifères marins
Nous constatons une augmentation des impacts anthropiques sur les océans et leurs ressources, là où les mammifères marins passent la totalité ou une partie importante de leur vie. La pêche et le transport maritime autochtones sont toujours extrêmement importants, mais ils sont désormais rejoints par d’autres activités telles que le développement de l’aquaculture, la pêche récréative et commerciale et l’écotourisme.
Les océans du Canada font partie intégrante de l'identité sociale et culturelle du Canada. Cependant, de nombreux habitats utilisés par les mammifères marins chevauchent les zones des communautés côtières, cela entraîne diverses interactions et impacts. Les menaces qui pesent sur les mammifères marins comprennent la disponibilité limitée des proies, les perturbations physiques et acoustiques, la contamination de l'environnement, les collisions avec des navires et les enchevêtrements dans les engins de pêche.
La gestion des impacts sur les mammifères marins est complexe. En tant que supers prédateurs les mammifères marins sont impactés par leur réseau alimentaire, l’environnement océanique, les changements liés au climat et les activités humaines.
Pêches et Océans Canada (MPO) a la responsabilité de conserver et de protéger les espèces de mammifères marins dans les eaux canadiennes. Le MPO pratique une approche prudente et travaille avec divers partenaires pour élaborer des mesures de gestion des impacts dus aux activités humaines, notamment des stratégies visant à soutenir le rétablissement des espèces en péril.
L’engagement du MPO à gérer de façon coordonnée se reflète dans son approche collaborative. Nous travaillons avec des agences gouvernementales multi-juridictionnelles, des groupes autochtones, des parties prenantes et des communautés côtières réunissant un grand nombre d’intérêts, d’activités et de problèmes liés au milieu marins dans toute la Colombie-Britannique.
Cet effort de collaboration implique la coordination et l’intégration de données scientifiques et de connaissances autochtones qui éclairent les processus décisionnels à l’appui de notre principal objectif et de notre défi le plus important : trouver un équilibre entre conserver des populations de mammifères marins en bonne santé et soutenir une économie bleue dynamique et durable.
Ce cadre explique l’approche intégrative que nous adoptons pour prévenir, réduire et atténuer les menaces qui pèsent sur les populations de mammifères marins dans nos eaux et décrit la manière dont nous répondons aux préoccupations socio-économiques.
Pour nous rapprocher de notre objectif fondamental, nous avons établi les cinq objectifs de gestion ci-dessous. Ceux-ci sont présentés dans la partie 3 de ce cadre qui fournit pour chaque objectif le contexte, les principaux domaines d'intérêt, certaines des actions et certains programmes de gestion actuels en cours. Pour plus d’informations, des outils de réglementation pertinents et des liens sont également inclus. La fonction de cette partie n'est pas de fournir un résumé complet de tous les efforts pour ces objectifs.
Cinq objectifs de gestion axés sur l’action (présentés dans la partie 3)
- Intégrer - recueillir des données scientifiques, économiques et socioculturelles et des connaissances autochtones sur les mammifères marins.
- Conserver - maintenir les populations de mammifères marins en bonne santé.
- Protéger - maintenir les populations de mammifères marins en bonne santé. .
- Soutenir - soutenir la participation des Autochtones à la gestion des mammifères marins, notamment dans le cadre de l’accès à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR).
- Maintenir - soutenir les secteurs économiques marins pour les Canadiens, les communautés autochtones et côtières tout en trouvant un équilibre entre la conservation et la protection des mammifères marins.

La Colombie-Britannique est si productive sur le plan biologique que 25 % de toutes les espèces de mammifères marins connues dans le monde ont été recensées dans les eaux de la Colombie-Britannique.
Plus de 30 espèces de mammifères marins vivent ici. La Colombie-Britannique (C.-B.) possède plus de 25 000 km de côtes constituées d'un réseau complexe de fjords profonds comprenant divers habitats qui soutiennent des écosystèmes particulièrement productifs avec plus de 30 espèces de mammifères marins, notamment des baleines, des dauphins, des marsouins, des otaries, des phoques et des loutres de mer. Parmi ces mammifères certains sont les plus gros animaux de la planète, ce sont des espèces emblématiques d'une grande importance culturelle pour les peuples autochtones et les Britanno-Colombiens, de même que les espèces visées par la Loi sur les espèces en péril du Canada (LEP).
Gestion des mammifères marins: rôles, responsabilités et partenaires
Cette partie présente les principales responsabilités, les rôles et les partenaires mobilisés dans la gestion des mammifères marins de la région du Pacifique sur la côte ouest du Canada. Elle présente également les principaux outils de réglementation pour une bonne gouvernance.
Les responsabilités fédérales comprennent la recherche, la surveillance, l'application de la loi, l'intendance, l'éducation et la sensibilisation.
Rôles - Gouvernement du Canada
Pêches et Océans Canada (MPO)
Le MPO participe avec ses partenaires à divers processus de consultation, d'échanges et de planification collaborative de la conservation qui servent de base à la recherche et à la gestion des mammifères marins du MPO. En plus des consultations, le MPO engage différents groupes à participer au processus de planification collaborative. Il s'agit notamment d'échanges bilatéraux, de processus consultatifs, de groupes de travail techniques et de tables rondes.
Les responsabilités fédérales dans la gestion des mammifères marins sont la recherche, la surveillance, l'application de la loi, l'éducation, la sensibilisation et l'intendance.
Le MPO est responsable d'élaborer et de mettre en œuvre les politiques et les programmes visant à soutenir les intérêts économiques, écologiques et scientifiques du Canada dans les eaux marines. La gestion des mammifères marins par le MPO est guidée par un cadre législatif et réglementaire. L'élaboration des politiques s'appuie sur une approche prudente, ce cadre comprend la Loi sur les pêches, la Loi sur les océans, la Loi sur les espèces en péril et le Règlement sur les mammifères marins.
Le ministre des Pêches et des Océans et de la Garde côtière canadienne nomme les agents des pêches chargés de faire respecter les règlements et les mesures de gestion des pêches, notamment pour les mammifères marins.
Les efforts pour faire appliquer la loi sont déployés par les agents des pêches du MPO lors de patrouilles aériennes, maritimes et terrestres. La surveillance des bateaux de pêche est effectuée par les observateurs, la surveillance à quai et la surveillance électronique à distance. Le Programme de conservation et de protection (C et P) du MPO joue un rôle important dans la gestion de la protection des mammifères marins en Colombie-Britannique. Mise en œuvre en vertu de la législation et de la réglementation pour promouvoir la conservation des ressources de la pêche et des habitats et des mammifères marins, C et P soutient l'intégration de programmes d'éducation formelle et informelle, les accords de cogestion/partenariat, la surveillance, le contrôle et la surveillance terrestre, maritime et aérienne, les inspections et le contrôle de la conformité des services tiers, les prestataires de service et les mesures d'application de la loi en cas de transgression de la loi, les enquêtes sur les cas importants/spéciaux grâce à la collecte et à l'analyse formelle d'informations, aux audits médico-légaux et aux poursuites judiciaires.
Garde côtière canadienne
En tant qu'organisme de service spécial du MPO, la Garde côtière canadienne (GCC) est chargée de fournir des services de communications maritimes, de gestion du trafic maritime et de gestion des incidents en cas de déversements dans le milieu marin en vertu de la Loi sur la protection des pêches côtières. Ces fonctions peuvent être appliquées pour atténuer certains risques pour les mammifères marins, tels que les collisions avec des navires et les déversements de pétrole.
Les rôles de la gestion des mammifères marins sont encadrés par un appareil législatif et réglementaire qui comprend la Loi sur les pêches, la Loi sur les océans, la Loi sur les espèces en péril (LEP) et le Règlement sur les mammifères marins
En 2020, la GCC a créé le bureau des mammifères marins dont la mission est de gérer le trafic maritime et de recevoir les rapports d'observations de baleines qui fournissent une meilleure connaissance des activités des épaulards résidents du Sud et des autres cétacés. Il fonctionne 24h/24 heures par jour, sept jours par semaine. Le bureau des mammifères marins exploite des technologies modernes, notamment le radar et les systèmes d'identification automatique (SIA) et les informations sur les mouvements des navires en temps réel. Il aide aussi ses partenaires comme Transports Canada en surveillant les mesures de gestion conçues pour contribuer à la survie et au rétablissement des épaulards résidents du Sud.
Environnement et changement climatique Canada
Environnement et Changement climatique Canada est responsable de la gestion des produits chimiques qui constituent une menace pour l'environnement. De nombreuses substances chimiques se retrouvent dans le milieu aquatique, ce qui présente un risque pour la santé des mammifères marins. Les substances qui persistent dans l'environnement et peuvent s'accumuler dans les tissus adipeux des animaux marins (en raison de la bioaccumulation) sont particulièrement préoccupante. Les contaminants sont rejetés via les eaux usées municipales et industrielles, le ruissellement urbain et agricole et provenant d'autres sources.
Le Plan de gestion des produits chimiques (PGPC) du Canada est une initiative visant à réduire les risques posés par les substances chimiques pour les Canadiens et l’environnement. Par l'intermédiaire du PGPC, le gouvernement du Canada évalue et gère les risques pour la santé humaine et l'environnement causés par les substances chimiques qui peuvent être présentes dans les aliments et les produits alimentaires, les produits de consommation, les cosmétiques, les médicaments, l'eau potable et les rejets industriels.
La Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) (LCPE (1999))est le principal élément du cadre législatif visant à protéger l'environnement et la santé humaine contre la pollution au Canada. Un aspect essentiel de la LCPE 1999 est la prévention et la gestion des risques dus aux substances toxiques et autres substances nocives.
Le Règlement sur certaines substances toxiques interdites prohibe les substances déclarées toxiques pour l'environnement et/ou la santé humaine en vertu de la LCPE (1999). Depuis leur création, ce règlement a été modifié ou republié à plusieurs reprises pour ajouter ou supprimer des substances, ou pour supprimer des dispenses. En 2022, des modifications apportées à ce règlement concernant certaines substances toxiques interdites ont été proposées pour introduire des restrictions sur deux nouveaux retardateurs de flamme, puis pour augmenter les restrictions sur cinq produits chimiques utilisés comme retardateurs de flamme et comme oléofuges et hydrofuges, dont certains ont été considérés comme des substances particulièrement préoccupantes pour les baleines en voie de disparition.
Parcs Canada
L'Agence Parcs Canada est responsable de la création des aires marines nationales de conservation en vertu de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada. Leur but est de protéger et de conserver des sites géographiques importants pour le bénéfice, l'éducation et le plaisir du public. L'Agence Parcs Canada est aussi responsable de la création de parcs nationaux en vertu de la Loi sur les parcs nationaux du Canada qui comprennent aussi des parties marines. En vertu de la Loi sur les espèces en péril, l'agence est responsable des individus et des espèces en péril qui se trouvent dans ou sur les terres fédérales qu'elle administre.
La gestion des mammifères marins en Colombie-Britannique est un processus dirigé par le MPO et rendu possible grâce aux efforts de collaboration des partenaires provinciaux, des groupes autochtones, des intervenants et des communautés côtières.
Les gardes de Parcs Canada mènent des activités de sensibilisation et d’éducation. Ce travail se déroule dans la réserve de parc national Pacific Rim, la réserve de parc national des Îles-Gulf, la réserve de parc national Gwaii Haanas, la réserve d'aire marine nationale de conservation et le site du patrimoine haïda, ainsi que lors de patrouilles en mer. Is sont également responsables de l'application de la Loi sur les parcs nationaux du Canada et d'autres lois fédérales et provinciales liées au mandat de Parcs Canada.
Transports Canada
Le Canada est responsable des politiques, des plans et des programmes de transport du gouvernement visant à promouvoir un transport sûr, sécuritaire, efficace et respectueux de l'environnement partout au pays. Transports Canada élabore des politiques et des règlements pour tous les modes de transport, notamment celui les marchandises dangereuses. Il veille aussi à la sécurité du système de transport. Dans le secteur maritime, Transports Canada assure la sécurité des voies navigables en réglementant et en surveillant les embarcations de plaisance et les navires commerciaux immatriculés à l'étranger. Transports Canada a pour mandat de protéger le milieu marin en ce qui concerne la navigation, la sécurité et le transport maritime en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada de 2001 et de la Loi maritime du Canada. Ce ministère dirige également le Plan canadien de préparation et d'intervention pour lutter contre les déversements d'hydrocarbures en mer, en coordination avec d’autres ministères gouvernementaux, notamment la GCC et le MPO. En 2018, la Loi sur la marine marchande du Canada a été modifiée pour inclure des dispositions visant à réagir plus rapidement et plus efficacement aux événements de pollution marine et à mieux protéger les écosystèmes et les habitats marins.
Transports Canada participe également à l'élaboration de mesures de gestion visant à atténuer le bruit sous-marin et les perturbations causées par les grands navires commerciaux et les petits bateaux de plaisance.
Ministère de la défense nationale
Le ministère de la Défense nationale (MDN) soutient les Forces armées canadiennes qui servent sur mer, sur terre et dans les airs avec la Marine, l’Armée, la Force aérienne et les Forces spéciales pour défendre les intérêts des Canadiens au pays et à l’étranger.
La Marine royale canadienne mène périodiquement des exercices militaires dans des zones marines écologiquement sensibles et/ou des habitats essentiels. Il s’agit de plusieurs plateformes militaires pour réaliser des exercices de formation.
Avant de mener des exercices, le MDN vérifie que ses activités fassent courir le moins de risques possibles aux populations de mammifères marins. Des mesures d'atténuation appropriées sont mises en place, notamment pour les espèces de mammifères marins inscrites sur la liste de la LEP.
Nous respecterons nos valeurs fondamentales en période d’incertitude
À Pêches et Océans Canada, la conservation du milieu marin s'appuie sur des valeurs fondamentales qui influencent les décisions de gestion qui concernent les utilisations humaines de nos océans et de leurs ressources. Pour respecter ces valeurs, il convient d'adopter l'approche de précaution qui consiste à faire preuve de prudence lorsque les connaissances scientifiques sont incertaines, à ne pas utiliser le manque d’informations scientifiques pertinentes comme prétexte pour reporter à plus tard une mesure ou à ne pas agir pour éviter de graves dommages aux stocks de poissons ou à leur écosystème.
Le MPO est responsable de mettre en œuvre les dispositions des principales exigeances réglementaires, notamment la Loi sur les pêches et le Règlement sur les mammifères marins..
Outils pour une bonne gouvernance - cadre législatif
Loi sur les pêches
La Loi sur les pêches énonce les dispositions et les principes qui permettent au MPO de conserver et de protéger le poisson et son habitat partout au Canada et d'autoriser la récolte. La définition de poisson en vertu de la Loi sur les pêches inclut les mammifères marins et toutes parties d'animaux marins.
Réglementation des mammifères marins
Au cours des dernières décennies de pêche commerciale, de nombreuses espèces de mammifères marins ont été décimées, certaines ont même disparu. Cependant, dans les années 1970, des règlements ont précédé le Règlement sur les mammifères marins actuel et ont été mis en place pour protéger les mammifères marins. Conformément à l'article 43 de la Loi sur les pêches, le Règlement sur les mammifères marins prévoit la gestion et le contrôle de la pêche des mammifères marins, ainsi que la conservation et la protection des mammifères marins au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes.
Ces règlementations constituent le principal instrument de réglementation utilisé pour gérer les interactions avec les populations de mammifères marins.
Loi sur les océans
Les mammifères marins passent la totalité ou la majorité de leur vie dans le milieu marin. La Loi sur les océans définit les pouvoirs nécessaires pour protéger l'habitat océanique, établir des aires de protection marine (APM) et soutenir une gestion coordonnée des océans. La Loi sur les océans définit également des outils non réglementaires et réglementaires relatifs à la qualité du milieu marin, tels que des objectifs, des critères, des lignes directrices et des normes.
Loi sur les espèces en péril (LEP)
La Loi sur les espèces en péril (LEP) est entrée en vigueur en 2003 « pour empêcher la disparition ou l’extinction d’espèces sauvages, pour assurer le rétablissement des espèces sauvages disparues, en voie de disparition ou menacées du fait de l’activité humaine et de gérer les espèces particulièrement préoccupantes afin d'éviter qu’elles ne deviennent en voie de disparition ou menacées ».
La LEP contient plusieurs interdictions visant à protéger les espèces inscrites à l'annexe 1 de la LEP. Selon les articles 32 et 33 de la LEP, les actions suivantes sont des infractions :
- tuer, blesser, harceler, capturer ou prendre un individu d'une espèce sauvage répertoriée comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP ;
- posséder, collectionner, acheter, vendre ou échanger un individu (ou toute partie ou dérivé d'un tel individu) d'une espèce sauvage inscrite comme disparue du pays, en voie de disparition ou menacée en vertu de la LEP ; et
- endommager ou détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, ou qui est inscrite comme espèce disparue du pays si un programme de rétablissement a recommandé sa réintroduction dans la nature au Canada.
Le paragraphe 58(1) contient des dispositions interdisant la destruction de toute partie de l’habitat essentiel d’espèces en voie de disparition ou menacées inscrites sur la liste ou de toute espèce disparue du pays si un programme de rétablissement a recommandé la réintroduction de l’espèce à l’état sauvage au Canada. L'habitat essentiel c'est l'habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage inscrite sur la liste et identifié dans le programme de rétablissement ou dans un plan d'action pour l'espèce.
Pêches et Océans Canada, Environnement et Changement climatique Canada et l'Agence Parcs Canada (APC) partagent la responsabilité de la mise en œuvre de la LEP. Le ministre des Pêches et des Océans est responsable de la protection et du rétablissement des espèces aquatiques en péril relevant de la compétence fédérale, autres que les individus se trouvant dans ou sur les terres fédérales administrées par l'APC.
Responsabilités - gestion des mammifères marins au Canada
Leadership et collaboration
Le MPO est l'organisation principale mandatée par le gouvernement du Canada pour gérer et protéger les mammifères marins dans les eaux canadiennes, mais ce travail ne se fait pas seul. Le MPO s'engage à travailler en collaboration avec de nombreux groupes, notamment au sein du gouvernement fédéral et entre les niveaux de gouvernement, avec les peuples autochtones et les parties prenantes et à impliquer les Canadiens dans les décisions liées aux mammifères marins pour lesquelles ils ont un intérêt.
Le MPO travaille avec un réseau de partenaires pour gérer un grand nombre de sujets sur les mammifères marins nécessitant une expertise. Il s'agit des groupes autochtones, d'autres agences gouvernementales fédérales et provinciales, les organisations de pêche et de gestion de l'environnement, les organisations non gouvernementales environnementales (ONGE) et les communautés de la région qui, elles aussi, s'engagent à conserver et à protéger les mammifères marins, leurs habitats et leurs écosystèmes. Ces efforts de collaboration couvrent la surveillance, la recherche, les mesures de gestion, l'application de la loi, l'intendance, l'éducation et la sensibilisation. Ce cadre présente les efforts et les actions des groupes et des organisations autochtones comme des exemples significatifs, mais il ne s'agit pas d'un résumé exhaustif de tous les efforts.
Partenaires internationaux
Le Canada joue un rôle international en soutenant la conservation et la gestion des mammifères marins. Le MPO travaille avec d'autres organisations et organismes internationaux pour contribuer à la recherche scientifique, collaborer sur des approches de gestion et se conformer aux normes liées à la conservation et à une gestion durable des mammifères marins.
Le Canada adhère aux conventions et accords des Nations Unies. Il s'agit notamment de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique (CNUDB), de la Convention sur les espèces migratrices, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), ainsi que de l'Accord nord-américain de coopération environnementale et du Plan stratégique pour la coopération nord-américaine dans le domaine de la mer et de la conservation de la biodiversité (2003).
Le MPO a une solide expérience de collaboration avec les États-Unis pour aborder la conservation des mammifères marins dans les eaux internationales. La région du Pacifique du MPO travaille sur des programmes de recherche, de mesures de gestion, d'éducation et de sensibilisation avec la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) et le Washington State Department of Fish and Wildlife .
Le Canada collabore avec la Commission baleinière internationale (CBI) sur des initiatives de recherche et de gestion.
Les scientifiques canadiens fournissent des données à la CBI contribuant ainsi à informer le comité scientifique de la commission sur les stocks de baleines. Ces données sont utilisées pour promouvoir l'adoption de mesures de conservation et de gestion pour les mammifères marins au niveau international.
Les intervenants du MPO et du Canada sont membres du Réseau mondial d'intervention contre l'enchevêtrement des baleines de la CBI où le Groupe consultatif d'experts sur la réponse aux enchevêtrements partage ses connaissances et son expertise pour développer de meilleures pratiques. Le but est de soutenir les efforts internationaux visant à démêler les baleines enchevêtrées dans des engins de pêche ou des débris marins. Pour plus d’informations sur comment démêler les baleines, voir la partie 3 de ce cadre.
Le Canada respecte les normes internationales émanant de la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (CITES) qui concernent les mouvements transfrontaliers des mammifères marins. Il s'agit de la surveillance du commerce des mammifères marins et/ou de leurs parties entre les pays. Les travaux de la CITES sont dirigés par le Service canadien de la faune (SCF) d’Environnement et Changement climatique Canada qui fournit des données sur les espèces et leur commerce afin de respecter les engagements internationaux du Canada en matière de rapports au titre de la CITES.
Liens pour plus d'informations :
Après la conservation, le respect du droit ancestral des Premières Nations de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR) ou à des fins domestiques en vertu du traité a la priorité sur les autres utilisations de la ressource.
Outils pour une bonne gouvernance - respecter les droits des peuples autochtones
Les peuples autochtones ont des approches holistiques de gestion des écosystèmes aquatiques, notamment des mammifères marins, depuis des temps immémoriaux et avant la colonisation européenne. Les mammifères marins et la gestion des ressources aquatiques revêtent une importance particulière pour de nombreuses communautés autochtones. Les habitats des mammifères marins, les océans et les ressources aquatiques sont situés sur les territoires traditionnels de nombreux groupes autochtones. Les groupes autochtones considèrent la gestion de ces ressources comme primordiale et vitale. Ils jouent un rôle important dans la gouvernance et l’intendance des espèces et des écosystèmes marins.
Le gouvernement du Canada travaille avec les groupes autochtones qui recherchent un meilleur accès aux opportunités économiques liées aux ressources aquatiques pouvant contribuer au développement économique de leurs communautés. Par ailleurs, les groupes autochtones cherchent à jouer un rôle plus important dans l'intendance, notamment la recherche, la gestion des océans et de l'habitat, la conservation et la protection, les processus d'inscription sur la liste de la LEP, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de documents sur le rétablissement.
Engagement pour la réconciliation
Le MPO s'engage à reconnaître et à appliquer les droits des autochtones issus de traités liés aux pêches, aux océans, à l'habitat aquatique et aux voies navigables d'une manière conforme à l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, à la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et aux Principes fédéraux régissant le partenariat du gouvernement du Canada avec les peuples autochtones.
La stratégie de réconciliation du MPO-GCC fournit un document d'orientation pour permettre de mieux comprendre pourquoi et comment la réconciliation éclaire le travail du Ministère.
Devoir de consulter
Le gouvernement du Canada a le devoir de consulter et, le cas échéant, d'accommoder les groupes autochtones lorsqu’il envisage une conduite susceptible d’avoir un impact négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités, potentiels ou établis (Consultation et accommodation des Autochtones — Lignes directrices mises à jour à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour remplir l’obligation légale de consulter, 2011).
Échanges et consultation
La consultation est l'élément essentiel d’une bonne gouvernance pour l'élaboration des politiques et pour des prises de décisions pertinentes. Le Canada a un cadre législatif, contractuel et/ou commun où la loi oblige à consulter les groupes autochtones sur les questions pouvant avoir des implications sur leurs droits. Pêches et Océans Canada consulte les Premières Nations, les parties prenantes et les Canadiens sur les questions qui les concernent et les préoccupent.
En examinant les questions liées à la gestion des mammifères marins dans la région du Pacifique, Pêches et Océans Canada collabore avec les groupes autochtones par le biais de forums existants, de gouvernance tels que le Conseil des pêches des Premières Nations, et de manière bilatérale notamment grâce aux processus de traité existants et d'autres forums.
L'établissement d'un partenariat renouvelé avec les peuples autochtones est une priorité essentielle pour le gouvernement du Canada. La réconciliation est un cheminement continu et un engagement à long terme basé sur la reconnaissance des droits, le respect, la coopération et les partenaires.
Traités et accords de réconciliation
Traités et accords d'autonomie gouvernementale
En 2023, des traités modernes et des accords d'autonomie gouvernementale sont signés en Colombie-Britannique. Ils incluent tous des chapitres sur les pêches (Accord définitif Nisga'a, Tsawwassen, Accord définitif des Premières Nations, Accord définitif des Premières Nations Maa-nulth, Accord définitif de la nation Tla’amin (Sliammon), Loi sur l’autonomie gouvernementale sechelte). Les nations travaillent avec le MPO pour gérer les pêches visées par ces traités. Des traités historiques existent aussi en Colombie-Britannique (comme les traités Douglas).
Pour la liste actuelle des traités en C.-B. veuillez consulter le lien : https://www.pac.dfo-mpo.gc.ca/reconciliation/arrangements-ententes-fra.html.
Les chapitres sur la pêche des traités modernes articulent un droit de pêche issu du traité à des fins domestiques qui sont protégés en vertu de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Ayant négocié dans le cadre d'un accord parallèle, certaines Premières Nations signataires de traités modernes ont un accès commercial grâce à un accord de récolte en dehors du traité protégé par la Constitution.
Le Canada, la Colombie-Britannique et les représentants des Premières Nations de la Colombie-Britannique qui participent ont élaboré ensemble la Politique de reconnaissance et de réconciliation des droits qui établit le cadre et la façon la plus significative de travailler ensemble lors les négociations de traités. Il s'agit de la reconnaissance des droits, de l’élaboration conjointe de mandats et d'une plus grande flexibilité pour des accords progressifs et évolutifs.
Le MPO poursuivra son travail bilatéral avec les nations signataires de traités par l'intermédiaire d'organismes de gouvernance établis, tels que les sous-comités sur les mammifères marins, où les intérêts et les questions liés à la gestion des mammifères marins peuvent être discutés, notamment les droits de récolte de la faune.
Les négociations du traité sont en cours avec de nombreuses Premières Nations de l'ouest du Canada
Accords de réconciliation
En plus de négocier des traités, le gouvernement du Canada et Les peuples autochtones peuvent également négocier la reconnaissance des droits autochtones et d'autodétermination (RDAA) pour explorer de nouvelles façons de travailler ensemble et pour faire progresser la reconnaissance des droits autochtones et d’autodétermination.
Ces accords de réconciliation sont dirigés par Relations Couronne- Autochtones et Affaires du Nord Canada (RCCANC). Le MPO peut également négocier des accords de réconciliation concernant les ressources halieutiques directement avec les Premières Nations. Les but est de d'améliorer la gouvernance et la gestion collaboratives des pêches, des questions marines et aquatiques, des sciences de l'environnement et des dispositions en matière d'intendance, et de fournir un processus solide et significatif pour impliquer les parties prenantes. Ces accords peuvent également contenir des dispositions sur la pêche, les sciences de l'environnement et une gestion responsable.
Pour plus de détails sur le thème Respecter les droits des peuples autochtones, veuillez cliquer sur les liens suivants :
- Mise en œuvre de la Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
- Loi sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones
- Principes régissant la relation du Gouvernement du Canada avec les peuples autochtones
- Stratégie de réconciliation du MPO
- Réconciliation en Colombie Britannique et au Yukon
- La réconciliation, les partenariats et la pêche autochtone
- Informations sur les travaux du gouvernement du Canada pour faire progresser la réconciliation
Une coordination renforcée avec les groupes autochtones, d’autres gouvernements et intervenants contribue à améliorer la compréhension des menaces directes qui pèsent sur les populations de mammifères marins.
Partenaires - gouvernements, groupes autochtones et ONG
Provinces et municipalités
Les gouvernements provinciaux et les administrations municipales partagent les responsabilités liées aux impacts sur l'habitat des mammifères marins. Les provinces sont les principales responsables des terres provinciales, des rivages et des zones spécifiques du fond marin. Les municipalités sont responsables de nombreuses activités terrestres affectant le milieu marin.
Le gouvernement du Canada collabore bilatéralement avec la province de la Colombie-Britannique sur un certain nombre de questions liées aux mammifères marins ; en particulier pour les questions concernant la gestion des écosystèmes d'eau douce relevant des administrations fédérales et provinciales.
Les municipalités et les districts régionaux de la Colombie-Britannique sont habilités par la législation provinciale à traiter un grand nombre de sujets sur les questions concernant les environnements marins et les populations de mammifères.
Groupes autochtones
Les mammifères marins et la gestion des ressources aquatiques revêtent une importance particulière pour de nombreuses communautés autochtones. Les peuples autochtones ont des approches holistiques de la gestion des écosystèmes aquatiques, y compris des mammifères marins, depuis des temps immémoriaux et avant la colonisation européenne.
Les océans, les ressources aquatiques et les habitats des mammifères marins sont situés sur les territoires traditionnels de nombreux groupes autochtones de la Colombie-Britannique. Les groupes autochtones considèrent que la gestion de ces ressources est d'une importance vitale et jouent un rôle important dans la gouvernance et l'intendance des espèces marines et des écosystèmes.
Les groupes autochtones aspirent à un meilleur accès aux opportunités économiques liées aux ressources aquatiques qui contribuent au développement économique de leurs communautés. Ces groupes cherchent à jouer un rôle plus important dans l'intendance, notamment la recherche, la gestion des océans et de l'habitat, la conservation et la protection, les processus d'inscription sur la liste de la LEP, ainsi que l'élaboration et la mise en œuvre de documents sur le rétablissement.
Organisations non-gouvernementales environnementales
Les ONGE soutiennent diverses activités de gestion des mammifères marins, notamment la recherche et la collecte de données pour documenter l'élaboration et la mise en œuvre de mesures de gestion, ainsi que des activités d'intendance telles que la surveillance sur l'eau, l'éducation et la sensibilisation.
Communautés côtières autochtones
Le Programme des gardes-pêche autochtones joue un rôle important dans l'amélioration de la gestion des pêches dans les communautés côtières autochtones. Les gardiens participent à l'application de la loi, à la surveillance et à l'intendance pour assurer la conservation et la protection des ressources halieutiques dans leurs communautés. De plus, les gardiens peuvent être engagés dans la restauration de l'habitat, l'évaluation des stocks ou d'autres activités visant à promouvoir une pêche durable.
Pêches et Océans Canada et la Garde côtière canadienne gèrent les pêches du Canada et protègent ses eaux en veillant à ce que les océans et les autres écosystèmes aquatiques du Canada soient protégés contre les impacts négatifs.
Partenaires - engagements et responsabilités
Accountability is about reliably delivering on commitments in a transparent way, and providing information around how decisions are made.
La responsabilité consiste à respecter ses engagements de manière fiable et transparente et à fournir des informations sur la manière dont les décisions sont prises. Le Plan ministériel du MPO définit l’orientation des principaux plans, programmes, risques et ressources. Plusieurs éléments de ces plans sont liés à la protection et à une gestion durable des populations de mammifères marins, notamment :
- les pêches, les océans et autres écosystèmes aquatiques sont protégés contre toute exploitation et ingérence illégales ;
- de meilleurs partenariats incluant une participation et débouchant sur des résultats pour les peuples autochtones ;
- des projets de développement se déroulant dans ou à proximité de l'eau qui évitent, atténuent ou compensent efficacement les impacts sur le poisson et son habitat ;
- espèces/populations aquatiques en péril figurant sur la liste de la LEP pour lesquelles un programme de rétablissement/un plan de gestion est légalement requis ;
- des productions scientifiques en rapport avec les écosystèmes aquatiques sont disponibles ;
- la promotion d'un partage ouvert et transparent d'informations avec les nations autochtones dans le cadre de programmes d'échanges liés aux mammifères marins ; et
- un engagement sans faille du MPO pour la réconciliation.
En plus de ces documents annuels, le MPO répond aux principales recommandations, notamment les rapports du vérificateur général. Par exemple, en 2018, le commissaire à l'environnement et au développement durable a identifié un certain nombre de recommandations liées à la protection des populations de mammifères marins au Canada dans le Rapport 2 – Protection des mammifères marins. Un résumé des mesures prises à ce jour est également fourni dans le Rapport sur l'avancement du plan d'action de la gestion.
Nous sommes déterminés à bâtir des partenariats renouvelés de nation à nation, entre les Inuits et la Couronne et de gouvernement à gouvernement et avec les Premières Nations, les Inuits et les Métis.
Dans le cadre de cet engagement, nous avons élaboré la Stratégie de réconciliation du MPO et de la GCC.
La LEP prévoit que le ministre compétent soit tenu de faire un rapport sur la mise en œuvre des plans de gestion ou des stratégies de rétablissement cinq ans après leur inscription au registre public et par la suite tous les cinq ans jusqu'à ce que leurs objectifs soient atteints. Pour le plan d'action, le ministre compétent doit faire le suivi des progrès accomplis pour atteindre ses objectifs, évaluer et rendre compte de sa mise en œuvre et de ses impacts écologiques et socio-économiques cinq ans après son entrée en vigueur. La mise en œuvre de ces mesures contribue à répondre aux stratégies générales et aux buts et objectifs de rétablissement exposés dans les programmes de rétablissement.
Le MPO et la Garde côtière canadienne jouent un rôle essentiel dans la transformation du partenariat du Canada avec les peuples autochtones. Dans le contexte de la gestion des mammifères marins, ce cadre reconnaît que les pêches, les océans, les habitats aquatiques et les voies navigables marines revêtent une grande importance sociale, culturelle, spirituelle et économique pour de nombreux peuples autochtones.
Partenariats et communication des deux côtés de la frontière
Be Whale Wise (Soyez attentifs aux baleines) est un partenaire d'agences gouvernementales, d'organismes à but non lucratif et d'autres parties prenantes qui fait des recherches, met en œuvre et offre une formation sur les meilleures pratiques en matière de navigation autour des baleines des deux côtés de la frontière du Canada et des États-Unis. Créé en 2001, ce partenaire en pleine croissance sensibilise le public aux menaces qui pèsent sur les mammifères marins et à la meilleure façon de les aider grâce à un meilleur comportement en navigation.
Ce cadre de travail vise à guider les mesures de gestion actuelles et futures afin de maintenir des populations dynamiques de mammifères en Colombie-Britannique, aujourd'hui et à l'avenir.
Le MPO est responsable de la mise en œuvre des dispositions des principaux instruments de réglementation, notamment la Loi sur les pêches et des information sur la délivrance des permis comprenant une liste des permis accordés à la recherche scientifique sur les mammifères marins.
Bien que le MPO ait augmenté ses compétences et élaboré des mesures pour faire face aux menaces touchant certaines espèces de mammifères marins, comme la population d'épaulards résidents du Sud, il reste encore beaucoup à faire pour d'autres espèces.
En 2021, le MPO a publié le Cadre de responsabilisation pour les épaulards résidents du Sud : évaluation du soutien au rétablissement. Cette étude examine la manière dont les mesures de gestion des épaulards résidents du Sud contribuent au rétablissement de la population au fil du temps.
Ce cadre retient les données recueillies par le gouvernement du Canada et ses partenaires à partir de trois catégories d'actions prioritaires qui comportent chacune des indicateurs et des mesures de rendement. Ensemble, les informations recueillies sur ces catégories décrivent une pièce importante du puzzle et offrent un aperçu de la façon dont le gouvernement du Canada et ses partenaires soutiennent le rétablissement de l'épaulard résident du sud. Il nous donne des informations sur les tendances pour atteindre notre objectif, met en évidence les domaines dans lesquels nous avons besoin de faire des améliorations et fournit des informations pour les discussions à venir.
Le Programme d’intervention auprès des mammifères marins du MPO recueille et publie périodiquement des données liées à des incidents impliquant des mammifères marins. Il montre comment le MPO réagit aux incidents comme : des animaux malades, blessés ou en détresse, le harcèlement, les animaux morts, les enchevêtrements, les collisions avec des navires (collisions) et les échouages d'animaux vivants.
Le MPO fournit des informations à la National Oceanic and Atmospheric Administration sur les pêches canadiennes qui exportent vers les États-Unis afin d'assurer le respect des normes internationales et de répondre aux exigences des dispositions sur l'Importation de poisson et de produits du poisson de la Marine Mammal Protection Act des États-Unis. Cela comprend des informations sur la déclaration des prises accessoires de mammifères marins, les programmes de surveillance et les mesures d'atténuation.
Des travaux supplémentaires seront entrepris progressivement pour répondre aux priorités du gouvernement en s'appuyant sur les commentaires des groupes autochtones et des parties prenantes. Il s'agira de poursuivre l'élaboration de plans de gestion intégrée des espèces, de faire avancer les mesures de gestion fondées sur de nouvelles données scientifiques et de renforcer les mesures d'atténuation qui s'attaquent aux menaces directes sur les populations de mammifères marins.
Lien pour plus d'informations : Rapport annuel sur les incidents impliquant les mammifères marins
Gestion en action : objectifs, actions et programmes
Cette partie présente nos cinq objectifs axés sur l’action. Le contexte et les principaux domaines d'intérêt sont décrits pour chaque objectif, suivis de certaines actions et certains programmes de gestion actuellement en vigueur aujourd'hui. Des liens vers plus d’informations et d'outils pertinents de réglementation sont également fournis. Cette partie n'est pas un résumé complet de tous les efforts au niveau régional visant ces objectifs, elle donne plutôt un aperçu des efforts déployés actuellement.
Travailler ensemble pour atteindre les objectifs de gestion
La collaboration est fondamentale pour atteindre des objectifs de gestion interconnectés. Grâce à la collecte et au partage des données scientifiques, économiques et socioculturelles et des connaissances autochtones (objectif n° 1), nous améliorons la compréhension des populations de mammifères marins dans les eaux de la Colombie-Britannique, cela permet de perfectionner les mesures visant à protéger la santé des animaux (objectif n° 2) et à réduire les menaces auxquelles font face les mammifères marins et leurs habitats (Objectif 3). Une meilleure compréhension renforce aussi la participation des Autochtones à la gestion des mammifères marins (Objectif 4) et l’engagement collectif à trouver un équilibre entre la conservation marine et la pérennité des secteurs économiques (Objectif 5).
Objectif 1 - comprendre
Recueillir des données scientifiques, économiques et socioculturelles et des connaissances autochtones sur les mammifères marins
Contexte
- Mieux comprendre les populations de mammifères marins, les interactions écosystémiques et l'utilisation de l'habitat, tout en tenant compte des impacts du changement climatique.
- Améliorer la coopération dans la collecte, le suivi et la diffusion des informations.
- Utiliser la collecte coordonnée des données, le suivi, la recherche, la synthèse et le partage des informations, la communication et l'éducation de manière à ce que l'ensemble des connaissances pertinentes soit appliqué au processus de planification et au processus décisionnel, notamment les études scientifiques et les connaissances locales et autochtones.
- Promouvoir la compréhension des mammifères marins et de leur environnement marin, puis établir des liens avec d'autres processus et activités de collecte de connaissances.
- Renforcer les liens et continuer à établir des partenariats avec ceux qui mènent des recherches sur les mammifères marins.
- Fournir des données et des informations pour soutenir la planification du rétablissement des espèces en péril, les options d'atténuation et l'élaboration de politiques.
- Refléter le rôle historique et l'importance culturelle des mammifères marins pour les groupes autochtones.
- Lien pour plus d'informations : Carnets d’expéditions : activités scientifiques de terrain de la région du Pacifique
Contexte
La collecte de données, la coordination et l’intégration permanente d’informations sur les mammifères marins se trouvent au cœur de notre gestion. C'est une combinaison équilibrée de données scientifiques, économiques et socioculturelles et de connaissances autochtones. Toutes ces informations à la fois quantitatives et qualitatives provenant de tous les secteurs et disciplines est fondamentale pour notre processus décisionnel éclairé et transparent.
Le MPO collabore avec d'autres organisations fédérales pour soutenir l'élaboration de politiques qui tiennent compte de l'intégration des connaissances autochtones dans les processus décisionnels. Le MPO travaille aussi en collaboration avec des partenaires fédéraux sur l'Initiative d'un cadre politique en matière de connaissances autochtones dirigée par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada.
Recherche scientifique sur les mammifères marins
Le soutien de la recherche à la gestion des mammifères marins est important pour comprendre différents aspects de la biologie et du comportement des mammifères marins, il permet d'éclairer la gestion et la prise de décision fondées sur des données probantes. La recherche sur les mammifères marins du MPO a évolué ces dernières décennies pour soutenir les programmes sur les espèces en péril, la gestion des océans et la gestion des pêches.
Importance économique
Les mammifères marins fournissent des services écosystémiques essentiels pour les écosystèmes océaniques riches en biodiversité et une valeur socio-économique pour l’Économie bleue du Canada. La Colombie-Britannique est bien connue pour l'observation des baleines. Elle a une solide industrie commerciale d'observation des baleines qui emmène les Canadiens et les visiteurs observer les mammifères marins à l'état sauvage par bateau ou par avion.
La santé des populations et des habitats de mammifères marins procure également des avantages indirects aux pêches commerciales qui partagent leur aire de répartition. Les consommateurs et les gouvernements sont de plus en plus motivés pour soutenir les pêches commerciales qui font preuve de pratiques durables en éliminant ou en réduisant les risques pour les mammifères marins lors des activités de pêche.
Ces dernières années, des programmes et des initiatives internationales encouragent des pratiques de récolte plus durables qui réduisent considérablement les impacts sur les mammifères marins. Il s'agit notamment du processus de certification du Marine Stewardship Council et des dispositions de la Marine Mammal Protection Act (MMPA) des États-Unis pour les pêches étrangères qui entreront en vigueur en 2023. Les dispositions de la loi MMPA reflètent les inquiétudes des scientifiques et du public concernant le déclin ou l'absence de rétablissement de certaines espèces de mammifères marins du fait des activités humaines.
Au Canada et dans d’autres pays exportant du poisson et des produits de la pêche vers les États-Unis, l’initiative de la loi MMPA de la NOAA évaluera les programmes de réglementation visant à lutter contre la mortalité accidentelle et intentionnelle et les blessures graves des mammifères marins.
Importance socio-culturelle
Le MPO reconnaît que nos océans et toutes les ressources marines — avec les mammifères marins — font partie du bien-être de tous les Canadiens. Les possibilités d'observation des mammifères marins et des baleines dans la région du Pacifique ont une valeur sociale et récréative significative. Ces expériences accessibles au public contribuent à faire progresser l’éducation sur le monde marin et à renforcer un sentiment collectif de gestion marine.
Pour de nombreuses Premières Nations côtières, il existe un lien culturel et spirituel profond avec les mammifères marins et leurs habitats. Ce lien s’étend à la langue, aux connaissances traditionnelles et à la santé des communautés. La santé des ressources, notamment des mammifères marins, est directement liée à la santé de la culture autochtone.
Les baleines en général, notamment les épaulards, occupent une place centrale dans la cosmologie et la mythologie de certaines Premières Nations. Les orques sont considérés comme des créatures transformationnelles impliquées dans de nombreuses traditions orales et pratiques culturelles. Elles revêtent une grande importance au regard des droits de gouvernance. De nombreux groupes autochtones ont leurs propres lois traditionnelles, leurs enseignements et leur compréhension des responsabilités qui éclairent leurs propres méthodes d'évaluation du milieu marin et des plans de gestion. Historiquement, les Premières Nations côtières de la Colombie-Britannique chassaient les pinnipèdes, les petits cétacés et les loutres de mer et certaines chassaient les grandes baleines. Pour certaines nations, les mammifères marins continuent de jouer un rôle important dans leur économie.
L'importance des systèmes de connaissances autochtones (ISC) est évidente en ce qui concerne les exigences visant à les intégrer dans les accords de gestion écologique, les évaluations environnementales et les plans de rétablissement.
Systèmes de connaissances autochtones (SCA)
Les SCA peuvent être définis différemment selon les communautés autochtones. Les connaissances autochtones (CA) sont également appelées connaissances traditionnelles autochtones (CTA) et connaissances écologiques traditionnelles (CET).
Les SCA sont holistiques –prise en compte de l’inter-connectivité de systèmes entiers – et représentent un corps cumulatif de connaissances recueillies par un processus adaptatif. Transmis de génération en génération par les Premières Nations, Individus et communautés métis ou inuits, ces systèmes sont également spécifiques aux régions et aux localités et ne sont pas séparables de leurs gardiens du savoir qui entretiennent des liens régionaux, locaux et spirituels avec les écosystèmes et toutes les formes de vie végétale et animale.
En 2019, la Loi sur les pêches a été modifiée pour inclure des dispositions permet au ministre de tenir compte des connaissances autochtones dans la prise de décisions concernant les pêches, le poisson et son habitat et des dispositions pour une protection supplémentaire de ces connaissances lorsqu'elles sont partagées à titre confidentiel.
Le gouvernement du Canada et la communauté scientifique reconnaissent la nécessité de considérer les systèmes de connaissances autochtones de manière significative et respectueuse. Cela représente un défi pour les gestionnaires de ressources. Apprendre à impliquer respectueusement les détenteurs de connaissances est une priorité afin de garantir que les connaissances autochtones sont utilisées et partagées de manière acceptable avec d’autres groupes autochtones, parties prenantes, gestionnaires et décideurs. Les connaissances autochtones contribuent à une compréhension globale des stocks de poissons, des mammifères marins et de leurs habitats, en aidant à combler les lacunes dans les connaissances et à éclairer les décisions liées à la gestion des ressources et à la conservation des mammifères marins.
Programme de recherches du MPO
Le programme de recherche sur les cétacés se consacre à l’estimation de la taille de la population et à l’identification de l’habitat essentiel des espèces menacées et en voie de disparition. Il comprend :
- Le programme d'acoustique se sert d'instruments de surveillance acoustique passive (hydrophones) pour repérer la présence de différentes espèces de baleines et l'utilisation de leur habitat. Ils ont été déployés sur l'ensemble de la côte dans diverses zones au fil du temps et ont été récemment concentrés au large sur les monts sous-marins.
- Le recensement annuel des épaulards résidents du Nord recueille des informations démographiques sur la population qui sont utilisées pour déterminer les taux de croissance, la structure de la population et sa répartition sur l'ensemble de la côte. Les résultats du recensement sont publiés chaque année et un catalogue de photo-identification des épaulards résidents du Nord est mis à jour périodiquement.
- Relevés sur les loutres de mer qui fournissent des données sur l'abondance et la répartition de la population de cette importante espèce en cours de rétablissement.
- Enquêtes annuelles à partir de bateaux : L'Enquête internationale sur la mégafaune marine de la région du Pacifique (PRISMM) était la première menée à l'échelle de la côte pour collecter des données sur la répartition et l'abondance du plus grand nombre possible d'espèces de cétacés en utilisant un mélange d'instruments acoustiques et de méthodes visuelles.
Le Programme de recherche sur les pinnipèdes fait des relevés aériens des pinnipèdes (phoques et lions de mer) pour estimer l'abondance et la répartition et surveiller les tendances des populations. Ce programme évalue également le régime alimentaire des pinnipèdes, un domaine de recherche essentiel pour modéliser le rôle écologique des pinnipèdes.
Le programme de recherche sur les produits qui contaminent les baleines est axé sur la compréhension des facteurs affectant la santé des populations de baleines. Il s'agit notamment d'identifier et de repérer en priorité les contaminants les plus préoccupants pour les populations d'épaulards résidents. Des efforts sont menés à l'intérieur et à l'extérieur de leur habitat principal pour comparer les niveaux, d'autant plus que les espèces qui sont leurs proies migrent souvent à travers les limites de leur habitat principal. Une grande partie du travail consiste à mesurer les niveaux de contaminants chez les espèces qui sont leurs proies, comme le saumon quinnat, ainsi que chez d'autres espèces, comme les poissons fourrages qui forment le réseau trophique des mammifères marins. Grâce à la prise en compte du réseau alimentaire, le programme façonne les nouvelles Lignes directrices sur la qualité de l'environnement (LDQE) qui protègent davantage les espèces du niveau trophique supérieur telles que les épaulards. Des efforts sont également déployés en collaboration avec des pathologistes vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique pour mieux comprendre les impacts des biotoxines marines, souvent causées par des proliférations d'algues nuisibles (PAN) sur les mammifères marins échoués.
Les études sur les interactions saumon quinnat-épaulard permettent de mieux comprendre quand, où et comment les saumons quinnats adultes utilisent les zones ayant été identifiées comme habitat principal pour les épaulards. En outre, la manière dont les épaulards résidents du Sud utilisent les eaux côtières pour se nourrir et se déplacer permet de mieux comprendre leur régime alimentaire dans l'espace et dans le temps, et comment cela chevauche la répartition et la disponibilité du saumon quinnat en tant que proie principale.
Le programme de détection des baleines et d'évitement des collisions évalue l'efficacité de différentes technologies (acoustique, optique, y compris infrarouge, imagerie satellite, réseaux d'observation, relevés aériens, etc.) pour détecter et classer différentes espèces de baleines et la possibilité de les appliquer dans différentes parties de la côte.
L’Initiative pour la qualité de l’environnement marin (IQEM) du Plan de protection des océans contribue à notre base de connaissances sur la façon dont le bruit des navires affecte et impacte les cétacés. Jusqu'à présent, les efforts ont été largement concentrés sur les épaulards résidents du Sud. Des efforts plus récents se sont étendus à d'autres espèces et à leurs habitats respectifs. Pour les épaulards résidents du Sud, les efforts se concentrent sur la façon dont ils utilisent leur habitat afin de documenter les stratégies d’atténuation. Par ailleurs, le secteur des Sciences du MPO surveille les principaux habitats des épaulards résidents du Sud afin d'établir des niveaux acoustiques ambiants de référence (c'est-à-dire à partir des conditions actuelles) sur lesquels orienter un programme de compensation des navires commerciaux. Cette initiative englobe plusieurs projets dont :
- l'évaluation de l'efficacité des aires protégées pour atténuer les impacts des perturbations sur le comportement des épaulards ;
- des modélisations de d'utilisation de l'habitat des épaulards résidents du Sud ;
- une quantification de l'importance du banc Swiftsure pour les épaulards résidents.
- Pour réduire les impacts sur les épaulards résidents du Sud, la recherche sur les épaulards résidents du Nord sert d'indicateur pour évaluer l'activité vocale, les comportements et l'environnement acoustique à l'aide d'étiquettes d'enregistrement acoustique numérique.
Le Secrétariat canadien des avis scientifiques (SCAS) sert de principal forum ministériel pour l'examen par les pairs et l'évaluation de la recherche scientifique et de la littérature sur toutes les espèces. Le SCAS favorise les normes nationales d'excellence et coordonne l'examen par les pairs des évaluations et des conseils scientifiques. Le SCAS coordonne également la communication des résultats de l’examen scientifique et des processus consultatifs.
Le processus du SCAS pour la science des mammifères marins s'appelle le Comité national d'examen par les pairs des mammifères marins.
Les réunions offrent l'occasion d'un examen collaboratif des résultats scientifiques par des experts en mammifères marins de tout le Ministère et avec la participation d'autres organisations (hors MPO). À l'issue du Comité national d'examen par les pairs des mammifères marins, de l'examen et de l'approbation, les résultats scientifiques sont utilisés pour fournir des avis scientifiques sur la gestion et la conservation des mammifères marins au Canada.
Détection
La collecte et l'interprétation des données sur la présence des baleines peuvent aider à affiner les mesures de gestion. Le fait d'associer la capacité de mettre en œuvre et d’évaluer le succès de telles mesures peut conduire à de meilleurs résultats pour les mammifères marins tout en réduisant les impacts sur les groupes autochtones, les parties prenantes et le public.
La façon dont de nombreux mammifères marins communiquent, les détections peuvent être effectuées visuellement et acoustiquement. Les détections de mammifères marins peuvent être utilisées pour :
- développer et mettre en œuvre des approches de gestion ;
- informer les navigateurs pour atténuer les risques de collision avec des navires ;
- atténuer les impacts des déversements d'hydrocarbures et des interventions environnementales ;
- aider à éduquer, sensibiliser et faire respecter la règlementation ; et
- accroître notre compréhension d'espèces spécifiques et de la répartition de la population.
Les informations sur les observations de mammifères marins sont recueillies auprès de sources gouvernementales et non gouvernementales au Canada et aux États-Unis. Les méthodes consistent en détection terrestres (par exemple des caméras infrarouges, les observations d'observateurs) et la détection sous-marine ( hydrophones). Les données d'observations proviennent d'un certain nombre de sources, notamment du système d'alerte WhaleReport (WRAS) d'Ocean Wise Sightings Network, de la Garde côtière canadienne, de la flotte, des phares, de la surveillance aérienne du MPO, de Transports Canada, des observateurs en mer et au sol, des chercheurs et des experts.
Installations d'hydrophones pour les mammifères marins
Le bruit sous-marin peut avoir des effets significatifs sur les mammifères marins. Le déploiement d'hydrophones couplé à une modélisation prédictive peut être un outil utilisé pour aider les experts à mieux comprendre les impacts.
Un certain nombre d'installations d'hydrophones différentes sont en place pour :
- comprendre le bruit de base dans les zones fréquentées par les baleines grâce à des réseaux d'hydrophones passifs ;
- surveiller la présence, la répartition et le lieu de déplacement des baleines (par exemple, les vocalisations des épaulards et des baleines à bosse) afin de répondre aux déversements d'hydrocarbures, de réduire le risque de collision avec des navires et de soutenir la mise en œuvre de fermetures de pêche pour protéger les principales zones d'alimentation des épaulards résidents du Sud via des réseaux en temps quasi réel ;
- évaluer si les mesures de gestion réduisent les niveaux de bruit (Burnham et al. 2021) ; et
- promouvoir l'utilisation de la modélisation. Vous trouverez ci-dessous des exemples de programmes de détection acoustique dirigés par le MPO.
Le programme d'acoustique ambiante marine de la Direction scientifique du MPO a installé 12 enregistreurs acoustiques passifs autonomes pour surveiller le paysage sonore sous-marin dans certaines parties de l'habitat principal des épaulards résidents du Sud. Les informations évaluées dans le cadre de ce programme seront utilisées pour examiner les contributions acoustiques au paysage sonore à large bande provenant des sources naturelles et des sources anthropiques, et pour affiner la compréhension des contributions spatio-temporelles et de la composition globale du paysage sonore. Cela comprend l'identification et la caractérisation de la contribution au bruit des grands navires commerciaux et la modélisation de la contribution au bruit des grands navires commerciaux et de la réduction des mesures d'atténuation appliquées.
Le Réseau de suivi des baleines est un réseau d'hydrophones qui surveille en temps quasi réel l'emplacement des baleines dans le sud de la Colombie-Britannique et peut aider à déterminer la direction du déplacement des mammifères marins. Il soutient les mesures de gestion, notamment en répondant lorsqu'un événement d'urgence survient, comme un déversement de produits chimiques ou d'hydrocarbures. Il aide à la mise en œuvre de fermetures de pêche basées sur la présence confirmée d’épaulards résidents du Sud.
Grâce à son réseau d’hydrophones implantés à des endroits stratégiques de la côte ouest de l’île de Vancouver, des îles Gulf et du détroit de Georgia, le MPO et Google développent en collaboration un programme d’intelligence artificielle qui utilise les réseaux d’hydrophones existants pour détecter la présence des épaulards.
Le programme d’intelligence artificielle utilize des cris, des sifflements et des clics d’écholocation pour distinguer les cris des épaulards des autres bruits océaniques. Le Réseau de suivi des baleines soutient la mise en œuvre de fermetures de pêche dans la zone d’alimentation principale des épaulards résidents du Sud afin de mettre en œuvre des fermetures pour protéger cette zone une fois que la présence des baleines est confirmée dans la zone.
Si vous voyez des mammifères marins, veuillez contacter :
Tél : 1-866-I-SAW-ONE (1-866-472-9663)
Internet : Réseau d'observation de l'océan
Courriel : sightings@ocean.org
App: WhaleReport
Objectif 2 - conserver
Maintenir les populations de mammifères marins en bonne santé
Priorités
- Les efforts en faveur des décisions de gestion tiennent compte des changements dans l'écosystème qui peuvent affecter les espèces pêchées, y compris les effets des conditions météorologiques et climatiques, et les interactions des stocks de poissons ciblés avec les prédateurs, les concurrents et les espèces qui constituent leurs proies.
- Mettre en place des mesures adaptatives et souples en réponse aux résultats de la surveillance et de la recherche.
- Appliquer les mesures de conservation nécessaires au maintien de la diversité biologique et de la productivité du milieu marin, notamment en réduisant les impacts des activités humaines sur les mammifères marins et en créant des zones marines protégées.
- Aligner les efforts de gestion sur les objectifs de la LEP et les processus de planification du rétablissement.
Contexte
Les populations de mammifères marins en bonne santé ont des conditions démographiques qui préservent leur potentiel reproducteur, leur variation génétique et leur continuité culturelle.
Les actions visant à restaurer et à maintenir de nombreuses populations de mammifères marins ont été couronnées de succès grâce à une multitude d’efforts de conservation à différents niveaux allant de l'international au national, du régional au local. Elles impliquent les gouvernements, les ONGE, les communautés locales et les citoyens. Ce qui suit est une liste non exhaustive de certaines façons de travailler qu'utilise le MPO pour la conservation des mammifères marins.
Protéger les espèces menacées
Compte tenu du nombre de mammifères marins répertoriés en vertu de la Loi sur les espèces en péril (LEP) et d'une approche prudente de la gestion du MPO, l’alignement sur les OBJECTIFS de la LEP et les processus de planification du rétablissement est fondamental pour maintenir des populations de mammifères marins en bonne santé.
Il existe actuellement treize espèces de mammifères marins inscrites à la LEP en Colombie-Britannique : quatre en voie de disparition (4), quatre menacées (4), et cinq particulièrement préoccupantes (5).
La LEP est un outil important pour protéger ces espèces. Elle énonce les exigences relatives à l'élaboration de stratégies de rétablissement et de plans d'action pour les espèces inscrites comme disparues du pays, en voie de disparition ou menacées, ainsi que les exigences en matière de planification de gestion pour les espèces désignées comme préoccupantes.
En vertu de la LEP, le ministre compétent doit faire un rapport sur la mise en œuvre des plans de gestion ou des stratégies de rétablissement cinq ans après leur inscription au registre public, puis au cours des périodes de rapport de cinq ans par la suite jusqu'à ce que les OBJECTIFS soient atteints.
Une fois qu'un plan d'action entre en vigueur, le ministre compétent doit suivre et évaluer les progrès accomplis pour atteindre les OBJECTIFS, puis la cinquième année il doit rendre compte de leur mise en œuvre et des impacts écologiques et socio-économiques.
La mise en œuvre des exigences de la LEP aide à aborder les stratégies de gestion générales ainsi que les buts et les OBJECTIFS spécifiques présentés dans les stratégies de rétablissement. En 2022, la publication du Rapport sur les progrès de la mise en œuvre du programme de rétablissement des épaulards résidents (Orcinus orca) du Nord et du Sud au Canada pour la période 2015 à 2019 en fournit un exemple récent.
Planification des espaces marins (PEM)
La PEM est un processus collaboratif qui rassemble les gouvernements fédéral et provinciaux, les tcommunautés ainsi que les organisations et les parties prenantes pour coordonner l’utilisation collective des espaces marins afin d’atteindre les OBJECTIFS écologiques, économiques, culturels et sociaux. La planification de l'espace marin prend en compte la série d'activités humaines prévues pour une zone marine donnée au fil du temps (telles que la pêche, les utilisations culturelles, les zones de conservation, le développement énergétique, etc.) afin de maintenir nos océans sains et productifs pour les générations à venir.
Le groupe de conservation et planification des espaces marins du MPO travaille en collaboration avec la province de la Colombie-Britannique, les groupes autochtones et les parties prenantes pour examiner les impacts des activités humaines sur les écosystèmes marins en s'appuyant sur les connaissances autochtones et scientifiques comme sources d'information.
Zones marines protégées
Il existe actuellement 14 zones marines protégées (ZMP) en vertu de la Loi sur les océans au Canada, couvrant plus de 350 000 km2, soit environ 6 % des zones marines et côtières du Canada. Les ZMP contribuent à un environnement marin sain et offrent une solution basée sur l'espace naturel pour faire face aux impacts du changement climatique en protégeant les écosystèmes marins, les espèces et leurs habitats. Les ZMP contribuent également à la culture canadienne tout en soutenant la prospérité économique des économies locales et des communautés côtières.
Le gouvernement du Canada, la province de la Colombie-Britannique et les Premières Nations côtières travaillent ensemble pour élaborer une approche planifiée d'un réseau de zones marines protégées dans la bio-région du plateau Nord, une priorité du Plan de gestion intégrée de la côte nord du Pacifique qui a été signé en 2017. Des travaux sont également en cours pour les premières phases de planification (collecte de connaissances) dans le sud de la Colombie-Britannique.
Intervention lors d'incidents
Le Programme d'intervention auprès des mammifères marins du MPO soutient les interventions lors d'incidents impliquant des mammifères marins. En collaboration avec des organisations non gouvernementales, les experts du ministère de la côte Pacifique interviennent lorsque des mammifères marins sont morts ou en détresse, notamment pour les enchevêtrements, les grandes baleines piégées, les mammifères vivants échoués ou le décès de mammifères marins. Ce programme travaille avec des partenaires pour :
- suivre et réagir aux enchevêtrements de mammifères marins, aux échouages (morts et vivants), aux collisions avec des navires et à d'autres menaces ;
- quantifier les menaces qui pèsent sur les espèces de mammifères marins, en mettant particulièrement l'accent sur les espèces évaluées comme étant en péril ; et
- fournir des données et des informations pour soutenir les initiatives de planification du rétablissement des espèces en péril, les options d'atténuation et l'élaboration de politiques.
Il est important de réagir aux incidents impliquant des mammifères marins vivants pour réduire les menaces de blessures et de mort cela contribue à maintenir la santé des individus et au succès à long terme de l’espèce. Des membres formés du Programme d'intervention contre les mammifères marins et du matériel d'intervention sont répartis dans toute la région du Pacifique pour intervenir rapidement en cas d'incident concernant des mammifères marins. Cependant, cela ne devrait être fait que par des experts, car les mammifères marins peuvent être inutilement blessés par des actions bien intentionnées de personnes non formées essayant de sauver ou de soigner un animal, en outre, cela peut également présenter des dangers pour les humains.
Les décisions concernant les mesures à prendre en cas d'incident particulier dépendent de plusieurs facteurs, notamment la vulnérabilité de l'espèce (p. ex., ceux de la liste de la LEP et/ou l'évaluation du COSEPAC comme espèce en péril), l'état de l'animal, les preuves d'interaction humaine, la faisabilité et la logistique de la collecte ou de l'intervention, l'intérêt pour la recherche, le financement et la disponibilité du personnel requis.
À la fin d'une intervention ou d'une enquête, les données sont compilées dans une base de données centrale, les échantillons sont soumis pour des analyses plus approfondies et toutes les personnes impliquées dans l'intervention et les domaines d'études connexes sont informés des résultats. Documenter ces incidents et, en cas de mortalité, comprendre la cause du décès, contribue à la compréhension des principales menaces anthropiques affectant le rétablissement des populations de mammifères marins.
Il convient de noter que les incidents signalés concernant des mammifères marins ne représentent qu'une partie du nombre réel d'incidents impliquant des mammifères marins.
Ramener en toute sécurité les animaux échoués vivants dans leur habitat naturel est un travail dangereux qui nécessite l'intervention de professionnels formés et agréés.
Phénomènes d'échouage des cétacés
Les cétacés sont considérés comme échoués lorsqu'ils se trouvent sur une plage et ne peuvent pas retourner en mer. Des échouages de cétacés vivants se produisent chaque année en Colombie-Britannique à une fréquence de 10 à 30 incidents par an au cours des 10 dernières années. Les échouages de plusieurs animaux se produisant simultanément dans une zone définie sont appelés échouages massifs.
Il existe plusieurs causes anthropiques potentielles d'échouage, notamment le sonar actif, l'activité sismique, les enchevêtrements dans les engins de pêche, les collisions avec un navire/hélice provoquant des blessures et les contaminants. Les facteurs de stress naturels/non anthropiques comprennent les proliférations d'algues nuisibles, les maladies et les caractéristiques géographiques. Par exemple, il a été observé que certaines plages en pente douce dans l'océan peuvent nuire à la capacité de réfléchir sur les animaux les clics d'écholocation, ce qui les amène à nager directement sur la plage avant de pouvoir réagir et changer de direction. Les tentatives de recherche de nourriture des cétacés dans les eaux peu profondes et la tentative d’échapper à la prédation sont des causes naturelles courantes d’échouages de cétacés vivants.
Les animaux vivants échoués peuvent avoir besoin d’une assistance professionnelle pour retourner en toute sécurité dans leur habitat naturel. Ce travail est dangereux et dans tous les cas, des professionnels formés et autorisés travaillent ensemble pour intervenir auprès des mammifères marins échoués. Pour déterminer le meilleur plan d'action, le Programme d'intervention auprès des mammifères marins du MPO tient compte de l'emplacement, des conditions météorologiques, des espèces et du nombre d'animaux impliqués avant de déployer le personnel et l'équipement appropriés (tels que des élingues et des dispositifs de re-flottaison) nécessaires à chaque effort d'intervention.
Réadaptation
Vancouver Aquarium Marine Mammal Rescue Society (Société de sauvetage des mammifères marins de l'aquarium de Vancouver) est le seul centre de sauvetage dédié aux mammifères marins au Canada et l’un des plus grands au monde. Le centre fonctionne comme un hôpital et un établissement de soins pour les mammifères marins malades, blessés ou orphelins. Chaque année, le programme de sauvetage sauve plus de 100 mammifères marins et les aide à se remettre pour qu'ils soient relâchés dans leur habitat naturel.
Nécropsies
Le but des nécropsies de mammifères marins (autopsies d'animaux) est de fournir des informations sur la cause du décès, comme l'origine potentielle d'un problème de santé ou d'une menace pour une population. Des échantillons offrant des informations sur l'état reproducteur, l'histoire de la vie, la physiologie et les facteurs de stress anthropiques sont également collectés.
Le Programme d'intervention auprès des mammifères marins travaille en étroite collaboration avec les médecins vétérinaires du ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de la Colombie-Britannique pour entreprendre des autopsies. L'équipe travaille également avec des bénévoles formés pour recueillir des mesures morpho-métriques et des échantillons sur des animaux se trouvant dans des régions éloignées ou trop décomposés pour justifier une autopsie complète.
Au cours d'une année normale, des autopsies sont réalisées sur 10 à 20 grandes baleines et 40 petits mammifères marins. Environ 20 pour cent des nécropsies sont effectuées sur le terrain, généralement sur les grandes baleines, qui sont trop grosses pour être transportées, le reste est effectué dans le laboratoire du ministère de l'Agriculture de la Colombie-Britannique, dans des conditions contrôlées, avec un meilleur équipement et un meilleur support technique.
Il existe parfois des cas uniques où une mortalité importante d’une population de mammifères marins doit faire l’objet d’une enquête. Le MPO travaille avec les États-Unis, notamment la NOAA, le Ministère de la pêche et de la faune de l'État de Washington et le Département de la pêche et de la chasse de l'Alaska, pour surveiller de près et mieux comprendre ces événements.
Lien pour plus d'informations : Signaler un incident avec des mammifères marins en Colombie-Britannique
Ligne d'assistance téléphonique pour le signalement des mammifères marins
La ligne d’assistance téléphonique gratuite 24h/24 et 7j/7 de la C.-B. est le centre des appels pour signaler tout incident impliquant des collisions avec des navires, des mammifères marins échoués, malades, blessés ou décédés.
Tél : 1-800-465-4336 ou VHF Canal 16
Objectif 3 - protéger
Réduire les menaces qui pèsent sur les mammifères marins et leur habitat.
Priorités
- Appliquer les mesures de conservation nécessaires au maintien de la diversité biologique et de la productivité du milieu marin, notamment en réduire les impacts des activités humaines sur les mammifères marins et en créant des zones marines protégées.
- Réduire la perturbation des mammifères marins en atténuant les activités humaines grâce à la délivrance de permis, d'autorisations et de permis pour certaines activités.
- Fournir l'expertise, l'équipement et la capacité nécessaires pour répondre aux incidents liés aux mammifères marins tels que les enchevêtrements, les échouages et la réalisation d'autopsies, y compris le soutien au programme d'intervention sur les mammifères marins en collaboration avec les groupes autochtones, les groupes de conservation et les organisations non gouvernementales environnementales.
- Soutenir la conservation et la protection de l'habitat des mammifères marins, notamment la disponibilité des proies pour les espèces de cétacés figurant sur la liste de la LEP.
- Reconnaître l'impact des contaminants environnementaux sur les mammifères marins et leurs environnements, notamment les processus en cours pour élaborer et mettre en œuvre des réglementations ou des lignes directrices permettant de réduire la menace des contaminants, tout en menant des recherches et des activités de surveillance pour approfondir notre compréhension de leurs impacts.
Contexte
L'augmentation des activités humaines dans nos eaux entraîne une altération ou une destruction de l'habitat marin qui entraîne de graves répercussions sur la santé des populations de mammifères marins et menace la survie et le rétablissement des espèces en péril. Cette partie explique la manière dont les principales menaces préoccupantes identifiées ci-dessous sont traitées par le biais de mesures et de programmes de gestion ainsi que les principaux outils de réglementation en vigueur pour les réduire.
Principales menaces préoccupantes :
Le changement climatique
- Comprendre comment les changements écosystémiques résultant des changements liés au climat influenceront les schémas de migration et l'abondance de certaines espèces marines fait partie intégrante des pratiques de gestion durable. On s’attend à ce qu’en raison de l’augmentation des gaz à effet de serre, les océans du Canada deviendront plus chauds, plus frais, plus acides et moins oxygénés au fil du temps.
Perturbations physiques et acoustiques
- Les perturbations physiques et le bruit sous-marin sont liés à un grand nombre d’impacts sur les espèces marines. Les mammifères marins dépendent du son pour se nourrir, naviguer et communiquer, les perturbations acoustiques peuvent affecter des mammifères marins isolés ou des populations entières.
Collisions avec les navires
- Les eaux de la Colombie-Britannique présentent de fortes densités de mammifères marins et de trafic maritime, ce qui augmente les risques de collision avec des navires, reconnus dans le monde entier comme une cause importante de mortalité des cétacés.
Disponibilité des proies
- Une densité, une diversité et une qualité suffisantes des proies sont essentielles pour répondre aux besoins alimentaires nécessaires au maintien de la bonne santé des mammifères.
Interactions des pêches avec les mammifères marins
- Les enchevêtrements de mammifères marins dans les engins de pêche peuvent causer des blessures importantes qui affectent leur capacité à nager et à se nourrir et peuvent entraîner la mort.
- Une prise accessoire involontaire de mammifères marins durant la pêche constitue la première cause directe de décès et de blessures graves d'origine humaine chez les mammifères marins dans le monde.
- La déprédation est le prélèvement de poissons dans les engins de pêche par des mammifères marins. Il s’agit d’un comportement acquis qu’il est presque impossible de faire cesser une fois qu’il a commencé. Cela peut infliger des blessures graves aux populations de mammifères marins et avoir un impact sur les captures des pêcheurs et endommager les engins.
Pollution marine et contaminants
- L’augmentation de l’activité humaine sur, dans ou à proximité de nos eaux contribue à une augmentation de la pollution et des contaminants avec des impacts considérables sur la chaîne alimentaire marine. Compte tenu des faibles taux de reproduction actuels et de la petite taille des populations de certaines espèces de mammifères marins, les menaces pesant sur un individu peuvent avoir des effets importants à long terme sur des populations entières.
La compréhension de l’impact des changements climatiques sur l’océan et sur la santé des populations de mammifères marins fait partie intégrante d'une gestion durable.
Comprendre les impacts sur les mammifères marins liés au climat
Comprendre les impacts liés au climat sur les populations de mammifères marins est complexe, variable et difficile. On s’attend à ce que les océans du Canada deviennent plus chauds, plus frais, plus acides et moins oxygénés en raison de l'augmentation des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Les interactions humaines croissantes dans nos eaux influencent les impacts liés au climat sur les mammifères marins. Ces impacts peuvent s’accumuler au fil du temps et la capacité des espèces à résister à ces pressions est également incertaine.
Grâce à des programmes de recherche sur l’écosystèmes, le MPO étudie les changements climatiques et partage des informations dans le cadre d'un rapport sur l’état de l’océan Pacifique. Ces activités de recherche étudient certaines espèces de mammifères marins pour mieux comprendre comment les changements liés au climat influencent les conditions des environnements marins et d'eau douce, les schémas de migration et l'abondance, la disponibilité des proies et les impacts sur la santé et la survie en général. Certains de ces travaux comprennent :
- La surveillance des conditions physiques, biologiques et chimiques des environnements marins et d'eau douce.
- L'Initiative pour la recherche sur l'écosystème du détroit de Géorgie.
- La surveillance du bassin versant du fleuve Fraser.
Perturbations physiques et acoustiques
Les mammifères marins dépendent du son pour leurs processus vitaux. Les impacts de ce bruit peuvent affecter différemment des animaux isolés ou des populations entières, mais le bruit sous-marin a été associé à un grand nombre d'impacts sur les espèces marines, notamment :
- perturbation du comportement ;
- changement ou perte d'habitat ;
- bruits ocultants affectant la capacité des animaux à communiquer ;
- changements dans la physiologie, le comportement et/ou les niveaux de stress ;
- blessures permanentes, voire la mort ;
- possibilité d'entraver la capacité à se nourrir ou à chasser.
Certains habitats principaux chevauchent des endroits fortement utilisés par les humains, ce qui entraîne des perturbations physiques dues au bruit anthropique provenant des navires, des avions et des activités industrielles telles que le dragage, le battage de pieux, d'autres activités de construction, les tests sismiques et les sonars. De plus, le bruit se propage différemment selon la température de l’eau et les changements climatiques locaux affectent la façon dont le son se propage sous l’eau.
L'utilisation des navires et la présence humaine provoquent des perturbations physiques et, dans certains cas, ont été liées à des changements de comportement chez les mammifères marins, affectant notamment leur efficacité et leur succès en matière de recherche de nourriture. Même les embarcations à propulsion humaine, comme les canoës ou les kayaks, peuvent perturber, stresser ou empêcher les baleines de se nourrir.
Le Règlement sur les mammifères marins et les dispositions de la LEP interdisent spécifiquement la perturbation, les dommages et le harcèlement des épaulards. Le non-respect de ces règles peuvent entraîner des sanctions. Ces interdictions sont complétées par des lignes directrices pour l'observation des mammifères marins dans Soyez Attentif Aux Baleines (Be Whale Wise) : les lignes directrices pour la faune marine à l'intention des plaisanciers, des pagayeurs et des spectateurs sont disponibles en version papier auprès des bureaux locaux du MPO ou en ligne.
Initiative pour la qualité du milieu marin (IQMM)
Les activités humaines dans ou à proximité de l'océan peuvent produire des facteurs de stress tels que le bruit dans le milieu marin, perturbant essentiellement les espèces marines et leurs écosystèmes et notamment leur capacité à voyager, à communiquer et à trouver de la nourriture. Afin de préserver la qualité du milieu marin, le gouvernement du Canada collabore avec des partenaires indispensables pour :
- identifier et comprendre les facteurs de stress écologiques, tels que le bruit sous-marin d'origine humaine ; et
- élaborer et améliorer les mesures visant à atténuer les impacts des activités sur la santé et la qualité de nos océans, notamment les impacts sur les baleines et autres espèces marines.
Le bruit sous-marin a été reconnu comme un facteur de stress pour plusieurs espèces de mammifères marins. L'IQMM se concentre sur la compréhension et la gestion des facteurs de stress marins, notamment le bruit sous-marin et ses effets sur les mammifères marins et leur habitat. Les actions spécifiques de l'IQMM comprennent l'analyse des stratégies d'atténuation existantes, l'identification d'éventuelles lacunes en matière de gestion et l'ajustement des mesures existantes ou l'élaboration de nouveaux outils de gestion en vertu de la Loi sur les océans (ex. des critères, des lignes directrices, des OBJECTIFS, des normes et des règlements) pour répondre aux préoccupations de gestion et fournir une orientation et une plus grande certitude pour l’industrie et les utilisateurs de l’écosystème.
L’Initiative pour la qualité du milieu marin travaille également avec des partenaires et des intervenants fédéraux, provinciaux, territoriaux et autochtones pour lutter contre le bruit sous-marin dans les écosystèmes marins du Canada grâce à l’élaboration d’une Stratégie sur le bruit océanique pour le Canada. La Stratégie canadienne sur le bruit océanique définira la vision du gouvernement du Canada et guidera les futurs efforts fédéraux pour résoudre les problèmes prioritaires liés au bruit sous-marin. Il s'agit d'établir une approche pangouvernementale et un plan à long terme pour guider la recherche scientifique fédérale, le développement technologique et la gestion du bruit marin produit par l’activité humaine dans les océans du Canada.
La stratégie contribuera également à mieux coordonner et intégrer les efforts de collaboration sur le bruit océanique.
Dans le cadre de cette initiative, le MPO travaille aussi avec des partenaires pour rechercher et mieux comprendre comment le bruit généré par les navires affecte les baleines en déterminant les niveaux actuels du bruit sous-marin ambiant dans l'habitat de ces baleines et en étudiant l'impact des facteurs de stress écologiques sur les écosystèmes marins.
Programme de protection du poisson et de son habitat (PPPH) du MPO
Le PPPPH est responsable de l’administration des dispositions de la Loi sur les pêches sur la protection du poisson et de son habitat et des dispositions pertinentes de la LEP. Le programme mène un certain nombre d'activités à l'appui de la conservation et de la protection de l'épaulard résident du Sud et de sa principale proie (le quinnat). Le PPPH effectue également des examens réglementaires des projets réalisés dans et autour de l’habitat du poisson, élabore des orientations et des pratiques de gestion exemplaires, effectue une surveillance de la conformité et soutient les activités de conformité et d’application de la loi menées par la Direction de la conservation et de la protection (C et P) du MPO.
Le PPPH examine les projets de développement, dont beaucoup sont susceptibles de générer du bruit sous-marin pouvant entraîner des dommages et la mortalité des poissons, y compris des mammifères marins. Dans le cadre des efforts visant à atténuer les impacts de ces activités, des orientations régionales ont été élaborées pour les seuils acoustiques et les protocoles de surveillance.
Bien que des mesures soient en place pour réduire les perturbations physiques et le bruit dans l’habitat des baleines, il est difficile de surveiller et de comprendre l’impact de ces efforts. Par exemple, l’analyse des effets de toute réduction du niveau de bruit (ex. une réduction moyenne ou médiane du bruit ambiant) nécessite une surveillance pendant une période prolongée après la mise en œuvre de la réduction afin de déterminer s’il y a eu un effet positif pour les baleines. Même si cela est réalisé, il est difficile de déterminer si une réduction a eu un effet positif sur la population de baleines dans une zone spécifique. En effet il existe un certain nombre d'autres facteurs modifiant la présence de nourriture qui peuvent avoir un impact sur la présence des baleines dans une zone donnée. Les risques et les recommandations de mesures d'évitement et d'atténuation pour conserver et protéger le poisson et son habitat sont déterminés par la sensibilité des espèces, la rareté de l'habitat et les menaces au rétablissement. La surveillance de la conformité est effectuée pour garantir le respect de la Loi sur les pêches et la conformité avec les avis de pêche.
Lorsque les promoteurs ne sont pas en mesure d'éviter ou d'atténuer complètement les impacts sur le poisson et son habitat, leurs projets doivent obtenir une autorisation en vertu de la Loi sur les pêches. Si le projet est susceptible d'avoir un impact sur les espèces en péril interdit en vertu de la LEP, le PPPH examinera si les conditions de permis de la LEP peuvent être respectées avant la délivrance ou le refus d'une autorisation. Les autorisations comprennent des conditions d'autorisation que les promoteurs doivent respecter afin d'éviter, d'atténuer et de compenser (c'est-à-dire contrebalancer les impacts) les impacts sur le poisson et son habitat et pour réduire les impacts sur les espèces en péril et leur habitat.
Réduire les perturbations physiques et acoustiques grâce à la technologie de détection
Le MPO travaille avec le programme ECHO et utilise des hydrophones faisant partie du réseau de suivi des baleines pour rechercher et écouter les épaulards résidents du sud dans le sud des îles Gulf, une zone d'alimentation clé pour cette population de baleines.
Les détections confirmées d'épaulards résidents du sud dans le cadre de ces deux programmes soutiennent la mise en œuvre de fermetures de pêche qui contribuent à réduire la compétition entre les proies et les perturbations physiques et acoustiques dans cette zone d'alimentation.
Programme d’amélioration de l’habitat et de l’observation des cétacés (ECHO) de l’Administration portuaire Vancouver-Fraser
Ce programme a été lancé en 2014 pour mieux comprendre et réduire les effets cumulatifs du transport maritime sur les baleines sur toute la côte sud de la Colombie-Britannique. L'autorité portuaire reconnaît que l'activité maritime commerciale dans la région est en augmentation et peut avoir un impact sur les baleines en péril.
L’Administration portuaire de Vancouver-Fraser est responsable de l’intendance des terres et des eaux qui constituent la juridiction du port de Vancouver, à Vancouver et dans ses environs en Colombie-Britannique.
Groupe de travail consultatif d'ECHO
Créé en 2018, ce groupe de travail s'appuie sur les partenaires existants par le biais de groupes consultatifs et de comités. Son but est d'élaborer et de mettre en œuvre des mesures d'atténuation visant à réduire le bruit sous-marin produit par les grands navires commerciaux, ces derniers peuvent prendre volontairement des mesures telles que des ralentissements et des déplacements latéraux dans les voies de navigation afin de réduire les impacts acoustiques dans les habitats principaux des mammifères marins.
Collisions avec les navires
Chaque année, les collisions entre cétacés et navires sont signalées à la ligne d'assistance téléphonique du MPO. Il s’agit notamment de collisions avec des espèces en péril comme les épaulards, les baleines à bosse, les baleines grises et les rorquals communs et de petits mammifères marins comme les dauphins à flancs blancs du Pacifique, les marsouins de Dall et les marsouins communs.
La majorité des collisions signalées impliquent de petits bateaux (moins de 15 m) ; cependant les collisions avec des navires plus gros sont moins susceptibles d'être détectées et sont probablement sous estimées.
Les baleines à bosse sont les cétacés les plus fréquemment touchées en Colombie-Britannique en raison de leur abondance relative plus élevée et de leur tendance à se nourrir à la surface ou près de la surface (Laist et al., 2001). Les rorquals communs sont les espèces de cétacés les plus fréquemment touchés dans le monde.
Système d'alerte Signalement des baleines
En 2018, le Réseau d'observation des cétacés de la C.-B. a lancé le Système d'alerte Signalement des baleine qui diffuse des détails pertinents sur la présence des baleines aux grands navires commerciaux. Les informations sur la présence des baleines provenant d'observations en temps réel sont communiquées au BC. Réseau d’observations de cétacés via l’application Signalement des baleines (WhaleReport). Ces alertes informent les capitaines et les pilotes de la présence des cétacés à proximité, cela permet aux navires de mieux prendre des mesures, telles que ralentir ou modifier leur cap pour réduire les risques de collision et de perturbation.
Disponibilité des proies
La disponibilité des proies fait référence à la fois à l’abondance de nourriture pour les mammifères marins et à leur capacité à y accéder ou à la capturer avec succès. Pour les populations d'épaulards résidents du Sud, le saumon quinnat (photo ici) est la principale proie. Étant donné que les épaulards dépendent du son (écholocation) pour capter leur nourriture, le bruit sous-marin et le déclin des stocks de quinnat ont un impact combiné sur ces populations en voie de disparition.
Le rétablissement des mammifères marins peut être limitée par le manque de proies. La disponibilité des proies s'explique par leur abondance et leur accessibilité. La disponibilité dépend également de la densité et de la qualité des proies, ainsi que d'une diversité spatiale et temporelle suffisante tout au long de l'année pour maintenir la disponibilité. Le saumon quinnat, par exemple, est la principale proie des épaulards résidents du Sud. Une diversité suffisante des stocks de quinnat et une variété de schémas de migration spatiale et temporelle sont nécessaires pour maintenir la disponibilité tout au long de l'année (MPO, 2017)
L'accessibilité des proies est liée à la facilité d'obtention des proies et peut être affectée par des perturbations physiques ou acoustiques qui peuvent avoir un impact sur le succès de la recherche de nourriture des cétacés. Des perturbations peuvent être causées par la présence de navires et le bruit sous-marin qu'ils provoquent.
La réduction de la fréquence des perturbations physiques et acoustiques peut faciliter et faire mieux aboutir la recherche de nourriture et ainsi conduire à une meilleure condition physique, à un taux de survie plus important et à des naissances plus nombreuses.
Pour les espèces qui utilisent l'écholocation, comme l'épaulard résident du Sud, la réduction des interférences acoustiques avec l'écholocation pendant la chasse et la communication entre les membres des groupes diminuerait les interférences physiques des navires qui pourraient perturber les poursuites en surface, empêcher le partage de proies ou empêcher les animaux de se nourrir et de se déplacer. en dehors d'une zone.
Les recherches récentes et en cours approfondiront notre compréhension pendant que le MPO et d'autres chercheurs continuent de produire des nouvelles informations et de faire progresser les analyses scientifiques concernant la répartition, les proies et les besoins en matière d'alimentation.
Gestion des pêches
Le MPO adopte une approche écosystémique de la gestion des océans et des décisions en matière de gestion des pêches afin de protéger les écosystèmes aquatiques sains, productifs et stables.
Les pêches sont gérées conformément à la Loi sur les pêches, en utilisant des pratiques fiables, abordables, efficaces basées sur la science. Le MPO prend ses décisions de gestion en s'appuyant sur une approche prudente et les informations disponibles les plus pertinentes, notamment les informations scientifiques évaluées par les pairs et le savoir autochtone.
Dans le cadre des mesures visant à atténuer la menace de diminution de la disponibilité des proies des épaulards résidents du Sud, les mesures de gestion des pêches prévoient des fermetures pour aider à accroître la disponibilité du saumon, réduire la compétition entre les proies et diminuer les perturbations causées par les navires lorsque les épaulards résidents du Sud s'alimentent dans leur habitat principal au large de la côte ouest de l'île de Vancouver (banc Swiftsure), du détroit de Juan de Fuca, des îles Gulf et à l'embouchure du fleuve Fraser.
Ces mesures annuelles de gestion des pêches comprennent des fermetures de pêche par secteur pour les pêches récréatives et commerciales du saumon. De plus, il est également demandé aux pêcheurs de cesser volontairement la pêche (ne pas remonter les engins de pêche) à moins de 1 000 m des épaulards comme un moyen de réduire la compétition pour leur nourriture et les perturbations en leur présence.
Mise en valeur des salmonidés et restauration de l'habitat
Pêches et Océans Canada cherche à conserver les ressources existantes en matière de poisson et d'habitat du poisson, à protéger ces ressources contre les impacts futurs et à restaurer l'habitat du poisson. La Loi sur les pêches du Canada et la LEP fournissent une base juridique pour la conservation et la protection des poissons, des espèces aquatiques en péril et de leurs habitats.
Initiative de la Stratégie pour le saumon du Pacifique, Direction de l'intendance, Centre d'expertise en restauration du saumon
Le Centre d’expertise en restauration de l’habitat du saumon fait progresser la restauration de l’habitat conformément à l’orientation stratégique et aux priorités.
Les équipes opérationnelles régionales du centre d'expertise assurent la planification, la mise en œuvre et la surveillance des projets de restauration de l'habitat du saumon dans toute la région du Pacifique. Les équipes régionales du centre d’expertise fournissent des conseils, une expertise et des protocoles cohérents aux équipes régionales de toute la région.
Des projets de restauration de l'habitat du quinnat soutenant le rétablissement des épaulards résidents du Sud ont été financés grâce aux initiatives du gouvernement du Canada telles que les fonds pour la restauration de la côte du Plan de protection des océans, les fonds cofinancés pour l'innovation et le rétablissement du saumon de la C.-B., et plus récemment les fonds pour la restauration des écosystèmes aquatiques. Ces projets sont soutenus par les ingénieurs et biologistes de l’unité opérationnelle du centre d’expertise en partenariat avec les groupes autochtones et d'autres parties prenantes.
Une espèce fourragère est une espèce située en dessous du sommet d’une chaîne alimentaire aquatique, elle est une source de nourriture importante pour certains prédateurs et sa mortalité par prédation est élevée. Les poissons fourrages sont importants pour les populations de baleines, en particulier lorsqu'ils sont consommés directement comme proies. Ils représentent la part la plus importante du régime alimentaire des baleines à bosse. Un autre exemple, celui du saumon quinnat qui est une proie privilégiée des épaulards résidents.
Du point de vue de la gestion des pêches, les espèces seront pêchées à des âges où la mortalité est encore élevée en raison de la prédation. Les espèces fourragères subissent souvent d’importantes fluctuations naturelles de leur abondance en réponse à des facteurs environnementaux sur des échelles de temps comparables à une génération, voire plus courtes. Les espèces fourragères soutiennent souvent des prédateurs qui en dépendent. Ce sont des espèces qui obtiennent une part importante de leur ration alimentaire annuelle par la prédation des espèces fourragères. Lorsque l'abondance de l'espèce fourragère diminue sensiblement (que ce soit en raison de causes naturelles ou d'une surexploitation), le prédateur qui en dépend est susceptible de réagit biologiquement. Cela se traduit par des changements majeurs dans son régime alimentaire, une réduction de son taux de croissance et du stockage de ses graisses, une chute de la reproduction et/ou un retard de développement, et des changements dans les schémas de distribution saisonniers normaux.
Pour soutenir la gestion des espèces de poissons-fourrages, le MPO a élaboré une politique sur les espèces de poissons-fourrages. Elle énonce les principes, les OBJECTIFS et les réflexions sur la gestion des pêches qui récoltent des poissons-fourrages comme le hareng et le lançon du Pacifique.
Interactions des pêches avec les mammifères marins
Enchevêtrements
Le littoral du Canada est le plus long du monde, il mesure 243 042 km (il comprend la côte continentale et les côtes des îles au large). Une grande partie de la côte étant éloignée, les observations ou les rapports sur les enchevêtrements de baleines sont peu nombreux.
L’enchevêtrement de mammifères marins, dans les engins de la pêche récréative fixes, de la pêche commerciale et dans les engins de l’aquaculture (actifs et abandonnés) peut causer des blessures importantes et affecter leur capacité de nager et de se nourrir, dans certains cas cela peut même causer leur mort.
Les baleines peuvent également être empêtrées et piégées dans des engins de pêche tels que des casiers à crabes et se noyer. Les enchevêtrements récurrents ne sont peut-être pas mortels, mais ils peuvent avoir un impact sur les processus vitaux tels que l'alimentation, la reproduction, la migration ou l'élevage des baleineaux.
Au Canada, les signalements de mammifères marins empêtrés dans des engins de pêche sont traités par des équipes et des personnes spécialisés et, si possible, via le Programme d'intervention auprès des mammifères marins du MPO.
Programme d'intervention auprès des mammifères marins
Ce programme joue un rôle de premier plan dans les interventions impliquant le dégagement de tous les cétacés de la région du Pacifique. Les travaux se font avec le personnel qualifié du Vancouver Aquarium Marine Mammal Rescue pour les enchevêtrements de pinnipèdes.
Le MPO travaille avec des partenaires extérieurs, notamment Straitwatch, des ONGE, la pêche de prises sauvages, les industries de l'aquaculture et le monde universitaire sur une série d’initiatives d’atténuation et d'intervention, notamment l’éducation, la sensibilisation, la surveillance, le signalement et la rupture de la corde des engins de pêche fixes dans le but de réduire les risques de blessures graves, voire de décès. Quant aux sites aquacoles, il est désormais obligatoire de retirer les engins considérés comme entraînant un risque accru d'enchevêtrement des mammifères marins.
Les efforts pour dégager les cétacés peuvent commencer par le déploiement d'une balise satellite afin de suivre et de localiser l'animal pendant qu'une intervention est planifiée et mise en œuvre. Le marquage par satellite nécessite une réponse immédiate et doit être effectué par un personnel qualifié. Les dégagements sont effectués uniquement par des équipes formées et certifiées. Au cours des dernières années, le Programme d'intervention auprès des mammifères marins a organisé un certain nombre de séances de formation sur les balises satellites sur toute la côte de la Colombie-Britannique avec la participation des communautés des Premières Nations et d'autres partenaires dans le but d'améliorer le temps de réponse des balises satellites et d'augmenter la couverture territoriale de la côte.
Les sauvetages d'animaux enchevêtrés évitent d'autres blessures ou décès dus à la famine, à une infection ou à une noyade. Les mesures de dés-enchevêtrement sont également coûteuses et dangereuses. La sécurité des personnes, les contraintes environnementales, notamment les conditions météorologiques, la tombée de la nuit, l'état de la mer ou l'incapacité de suivre une baleine en transit, sont des éléments importants à prendre en compte lors des opérations de sauvetage.
Prises accessoires de mammifère marin
Les prises accessoires de mammifères marins sont définies comme la capture marins sont définies comme la capture accidentelle, la blessure ou la mort d'un mammifère marin lors des activités de pêche. Les prises accessoires de mammifères marins peuvent s'enchevêtrer, se blesser ou être stressés. De plus le retrait ou une fuite rapide des engins de pêche peut causer des blessures. Une estimation de plus de 650 000 individus est faite chaque année. Les prises accessoires constituent la première source mondiale de décès directs d’origine humaine et de blessures graves chez les mammifères marins.
Le terme prise accessoire dans le secteur de la pêche commerciale de poissons sauvages fait référence à un poisson (non ciblé) ou à une autre espèce marine capturé involontairement durant la pêche d'un poisson.
Dans les eaux canadiennes du Pacifique, les activités de pêche peuvent avoir lieu dans l’habitat des mammifères marins. Les mammifères marins peuvent être exposés aux engins de pêche pendant leur migration, pendant qu'ils se nourrissent, s'accouplent et élèvent leurs petits, ce qui peut les exposer à différents types d'engins de pêche dans différentes zones.
Les interactions varient en fonction du comportement et de la durée de séjour des mammifères marins dans une zone, de la nature et du type d'engin utilisé, ainsi que de la quantité d'engin présent. Au Canada, la gestion des prises accessoires dans les pêcheries constitue depuis longtemps un élément important de nombreux plans de gestion des pêches.
Les engins de pêche et les pratiques de récolte ont évolué pour améliorer la sélectivité de la pêche. Des efforts ont été déployés pour maximiser le potentiel de survie des prises remises à l'eau.
Les prises accessoires constituent la première source de décès ou de blessures graves d'origine humaine chez les mammifères marins dans le monde.
La Politique sur la gestion des prises accessoires a deux OBJECTIFS : garantir que les pêches canadiennes sont gérées pour que les espèces aquatiques soient récoltées de façon durable et pour réduire le risque que la pêche cause des dommages graves ou des dommages irréversibles, et en tenant compte des prises accessoires conservées et non conservées. Les pêcheries canadiennes sont tenues de respecter les dispositions réglementaires en vertu de la législation, des politiques et des conditions de permis qui comprennent des mesures de surveillance, de déclaration et d'atténuation en vue de réduire le risque de dommages accidentels auquel font face les mammifères marins.
Ces dernières années, de nouvelles exigences régionales, nationales et internationales sont entrées en vigueur pour renforcer les outils de surveillance et de signalement qui fournissent des données importantes sur les pêcheries présentant le risque le plus élevé d'interactions avec les mammifères marins.
Les permis de pêche commerciale énoncent des dispositions spécifiques qui soutiennent la gestion des mammifères marins. Celles-ci comprennent des exigences de surveillance avec l'utilisation de journaux de bord, la présence d'observateurs en mer et une surveillance électronique, ainsi que des mesures d'atténuation telles que le marquage des engins de pêche et des exigences de déclaration pour toutes les interactions liées à la pêche avec les mammifères marins.
Les conditions de permis de pêche précisent également que des formulaires de déclaration d'interactions avec des mammifères marins doivent être remplis et soumis en cas d'interactions accidentelles entre des engins de pêche ou des navires et des mammifères marins. Le signalement des interactions est acheminé via des lignes d’assistance téléphonique appropriées. Le signalement des incidents aide le MPO et les pêcheurs à comprendre ce problème et à élaborer des stratégies pour l'éviter.
Nuisance par les otaries
Le contrôle des prédateurs des mammifères marins est régi à l'échelle nationale par le Règlement sur les mammifères marins vertu de la Loi sur les pêches et, en vertu de cette loi, l'élimination des phoques nuisibles est strictement interdite. Le gouvernement travaille avec l’industrie pour développer et améliorer les mesures visant à prévenir les interactions et à contrôler les prédateurs.
Déprédation
La déprédation est le retrait du poisson des engins de pêche par les mammifères marins. Ce comportement appris peut se propager à tous les groupes sociaux de baleines et aux populations de pinnipèdes (c'est-à-dire les phoques et les lions de mer) et une fois qu'il est acquis, il est impossible de l'arrêter. Cela peut également nuire aux mammifères marins.
Des prédateurs ont été signalés par des pêcheurs en Colombie-Britannique et, dans certaines pêcheries, on sait que les mammifères marins retirent régulièrement les captures ou les appâts des lignes ou des filets des pêcheurs et des enclos d’aquaculture.
La déprédation peut affecter de manière significative le volume et la qualité des captures et augmente également la probabilité d'enchevêtrement ou de harponnage des mammifères marins. Afin d'éviter des pertes importantes pour les pêcheurs, il est essentiel que ceux-ci n'encouragent pas cette pratique en permettant aux mammifères marins de s'associer à eux lors des activités de pêche. Pour empêcher la propagation des comportements de déprédation, il est essentiel de ne pas nourrir les baleines directement ou indirectement, ni de transporter des engins de pêche à proximité.
Prédation dans les Installations d'aquaculture
On sait que les mammifères marins interagissent avec les installations aquacoles dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique. Les réglementations nationales et provinciales exigent que les titulaires de permis de pisciculture prennent toutes les mesures raisonnables pour réduire les captures accidentelles de poissons sauvages et les interactions avec les prédateurs.
Les exploitants d'enclos marins en filet utilisent des filets de protection pour décourager les oiseaux de saisir leur proie et peuvent utiliser des enclos à double paroi, des filets anti-prédateurs, des clôtures ou des barrières pour empêcher les mammifères marins comme les phoques, les lions de mer ou les loutres de mer de s'approcher des installations conchylicoles.
Le contrôle des prédateurs de mammifères marins est régi à l'échelle nationale par le Règlement sur les mammifères marins appliqué en vertu de la Loi sur les pêches et selon les conditions de permis.
Même si les mammifères marins doivent remonter à la surface pour respirer, ils ont peu ou pas d'odorat, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux marées noires
Contaminants
Les polluants chimiques et biologiques peuvent avoir un impact direct ou indirect sur les mammifères marins. Il s'agit notamment des polluants organiques persistants (POP) tels que les biphényles polychlorés, les pesticides actuellement utilisés et les métaux. Ceux-ci sont nocifs pour la santé des mammifères marins et peuvent endommager le système nerveux, ou avoir un impact sur le système immunitaire, les rendant plus sensibles aux maladies, ou altérer les capacités de reproduction.
Les polluants qui se bioaccumulent ou sont capables de se bioamplifier à travers la chaîne alimentaire sont particulièrement préoccupants pour les espèces prédatrices marines.
Les contaminants préoccupants sont caractérisés par la recherche et la surveillance et sont souvent identifiés dans les stratégies de rétablissement de la LEP propres à chaque espèce.
Tous les niveaux de gouvernement et les partenaires externes travaillent ensemble pour faire face aux menaces que représentent les contaminants pour le milieu marin et le gouvernement du Canada continue de faire face à ces menaces en renforçant la réglementation, en élaborant des lignes directrices et en augmentant la recherche et la surveillance.
L'outil d'inventaire des polluants affectant les baleines et leurs proies (OIPABP) est un outil de cartographie interactif en ligne qui montre des estimations des rejets de polluants par toutes les sources identifiées dans certains habitats des épaulards résidents du Nord et du Sud Sud et du saumon quinnat. L'outil affiche également les charges estimées de contaminants ambiants dans le bassin du fleuve Fraser et indique les endroits où les lignes directrices en matière de qualité environnementale ont été dépassées.
Incidents de pollution marine : déversements de produits chimiques et d'hydrocarbures
Les déversements de produits chimiques et de pétrole constituent une menace majeure pour les mammifères marins. Compte tenu des faibles taux de reproduction actuels et de la petite taille des populations de certaines espèces de mammifères marins, les impacts sur les individus peuvent avoir des effets importants à long terme sur des populations entières.
Les mammifères marins doivent également interagir avec la surface pour respirer, pourtant, ils ne semblent pas éviter les zones touchées par le pétrole, ce qui les rend particulièrement vulnérables aux marées noires. Ce manque d’évitement peut être dû à un odorat faible, voire inexistant.
De nombreux mammifères marins et espèces en péril, les loutres de mer dans leurs radeaux, les otaries de Steller dans leurs colonies de reproduction, les épaulards du large et les épaulards résidents du sud se trouvent souvent en très grands groupes avec une grande proportion de la population concentrée dans une zone relativement petite de la population concentrée dans une zone relativement petite de la population concentrée dans une zone relativement petite. de la population concentrée dans une zone relativement petite de la population concentrée dans une zone relativement petite.
Si un déversement de produits chimiques ou d’hydrocarbures se produit dans une petite zone, les populations risquent d’être touchées de manière significative. En raison du risque d'exposition par ingestion, inhalation ou contact direct, des mesures doivent être envisagées pour dissuader les mammifères marins de pénétrer dans les lieux de déversements de pétrole.
Les déversements de pétrole sont préjudiciables aux populations de mammifères marins pour un certain nombre de raisons, notamment la toxicité des vapeurs de pétrole, qui peuvent provoquer une détresse respiratoire lorsqu'elles sont inhalées. Il a été démontré que les cétacés exposés au pétrole ont un succès reproducteur réduit et de nombreux effets à long terme sur la santé qui les rendent plus sensibles aux agents pathogènes (Gregr et al., 2006).
Une exposition massive au pétrole peut également entraîner des lésions aux poumons, au foie et aux reins. Les déversements de pétrole peuvent également avoir un impact significatif sur la disponibilité et la qualité de leurs proies, et l'ingestion de proies mazoutées provoque de graves dommages à long terme aux organes internes (Rosenberger et al., 2017).
Des protocoles d'intervention et des programmes de formation sont en place pour gérer les impacts des incidents de pollution marine sur les mammifères marins.
Lorsque des mammifères marins sont touchés par des incidents de pollution marine, le Programme d’intervention pour les mammifères marins du MPO joue un rôle de premier plan sur l’eau.
Programme d'intervention pour déversement du MPO
Le Programme de planification coordonnée des interventions en milieu marin du MPO est activé lors de déversements en mer.
Intervention d'urgence en cas de pollutions marines
Les coordonnateurs des incidents environnementaux (CIE) sont chargés de coordonner toutes les informations scientifiques et techniques pour documenter les actions d’intervention. Toutes les directions générales du MPO peuvent être impliquées, notamment : la Direction de la gestion des écosystèmes, la Direction des sciences, de la conservation et de la protection et la Direction de la gestion des pêches.
Le MPO fournit des conseils et des recommandations scientifiques et techniques à l'agence fédérale autorisée à diriger l'intervention. L’expertise du MPO en matière de poissons et de mammifères marins, d’espèces aquatiques en péril, d’habitat du poisson et de pêches comprend :
Environnement et Changement climatique Canada (ECCC) coordonne tous les conseils et expertises scientifiques et techniques fédéraux, et les fournit à l'agence responsable de la gestion du déversement. Les informations sur les espèces, les habitats, les pêches, la faune, les données océanographiques et la modélisation permettent d'établir les priorités et les activités opérationnelles.
Le Centre national des urgences environnementales (CNUE) d’Environnement et Changement climatique Canada est le centre fédéral pour les conseils scientifiques et le soutien technique en cas d’urgences environnementales et offre des services pour une gestion efficace des incidents 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
La Garde côtière canadienne (GCC) est l'organisme responsable de l'intervention en cas de déversement d'hydrocarbures provenant de navires. La GCC est responsable fédérale de la planification opérationnelle et de la mise en œuvre des activités d'intervention en cas de déversement dans le milieu marin. Il s'agit de mettre en relation les Premières Nations et le pollueur responsable du déversement et de diriger l’élaboration de plans d’intervention dans les zones (PIZ) à grande échelle pour définir les rôles et les responsabilités des partenaires d’intervention en cas de déversement.
Programme d'intervention auprès des mammifères
Le Programme d’intervention auprès des mammifères marins du MPO joue un rôle de premier plan lorsqu’un incident de pollution marine nécessite une intervention sur l’eau impliquant des mammifères marins. Ce rôle est un effort coordonné avec la Garde côtière canadienne avec le soutien des agents de conservation et de protection.
Les rapports d’observations, la surveillance aérienne et d’autres données disponibles du MPO déterminent la présence et les déplacements des mammifères marins. Ces informations sont intégrées dans les plans d'intervention.
Si des mammifères marins sont détectés dans les zones de déversement, des experts en dissuasion sont déployés pour empêcher les mammifères marins de pénétrer dans les zones de déversement.
La toxicité du produit chimique déversé détermine les mesures d'intervention prises par les mammifères marins. En cas de rejet important de pétrole, les projections de la trajectoire du déversement ainsi que les données de localisation et de déplacement des mammifères marins sont analysées pour déterminer les menaces d'exposition au pétrole.
Règlementation pour les mammifères marins
La Règlementation sur les mammifères marins fournit des orientations sur la conservation et la protection des mammifères marins, des orientations pour le rétablissement des espèces en péril en vertu de la LEP et établit des dispositions relatives à la réduction des perturbations des mammifères marins causées par les humains (par exemple, l'observation de mammifères marins) et des exigences de déclaration obligatoires dans le cas de contact accidentel avec un mammifère marin et un navire ou un engin de pêche. Modifiés en 2018, ceux-ci précisent désormais les dispositions contraignantes pour prévenir toute perturbation des mammifères marins.
L'article 7(2) de la règlementation définit une perturbation comme une série d'actions humaines :
- nourrir, nager ou interagir avec un mammifère marin ;
- déplacer un mammifère marin (ou l'inciter/le faire bouger) ;
- séparer un mammifère marin de son groupe ou passer entre un adulte et un petit ;
- piéger un mammifère marin ou un groupe entre un navire et le rivage, ou entre un navire et d'autres navires ;
- marquer d'un mammifère marin.
L'article 8.2 du règlement décrit les distances d'approche. Les bateaux sont tenus de maintenir une distance d'approche minimale de 100 m pour les baleines, les dauphins ou les marsouins, de 200 m lorsque les baleines, les dauphins ou les marsouins sont en position de repos ou avec un petit, et de 200 m de tous les épaulards dans les eaux canadiennes du Pacifique. Cependant, dans les eaux côtières du sud de la Colombie-Britannique une distance d'approche minimale de 400 m pour tous les épaulards est requise, conformément à l'arrêté d'urgence adopté en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
Permis
Permis des mammifères marins, notamment la recherche, le transport, lale rétablissement, la possession et/ou les travaux, entreprises ou activités liés aux projets de développement, entre autres. Les autorisations, permis et licences sont délivrés en vertu de la Loi sur les pêches, de la LEP, du Règlement sur les pêches (dispositions générales) et du Règlement sur les mammifères marins. Les demandes de permis sont soigneusement évaluées afin d'éliminer ou de diminuer l'impact humain sur les mammifères marins grâce à une série de conditions en fonction de la nature de l’activité. De plus, la nature cumulative de ces activités peut être prise en compte à travers ces processus, tels que le Comité d’examen des permis en rapport avec les épaulards résidents du Sud qui garantit que les impacts sont pris en compte collectivement dans l’ensemble de ces activités.
Les projets de recherche ou de développement menant des activités susceptibles d'affecter les espèces de mammifères marins répertoriées comme « en voie de disparition » ou « menacées » en vertu de la LEP nécessitent un permis séparé délivré en vertu de la LEP, une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches faisant office de permis LEP ou, sous certaines conditions, un permis de pêche délivré en vertu de la Loi sur les Règlements des pêches (général) faisant office de permis LEP.
Les projets de développement qui affectent les espèces de mammifères marins qui ne sont pas répertoriées comme « en voie de disparition » ou « menacées » par la LEP peuvent nécessiter une autorisation donnée en vertu de la Loi sur les pêches s’il existe un risque de mort ou d’altération dommageable de destruction de l’habitat. Dans d'autres circonstances, un permis ou une autorisation en rapport avec les mammifères marins est requis en vertu du Règlement sur les pêches (dispositions générales) et du Règlement sur les mammifères marins.
La demande de permis du MPO comprend une évaluation des impacts et des mesures d'atténuation pour garantir que toutes les mesures ont été prises pour réduire les perturbations, les dommages et les effets anthropiques potentiels. Les permis sont délivrés sur une base d'un à cinq ans et nécessitent la soumission d'un rapport annuel pour permettre l'examen des activités et des résultats, ainsi que la prise en compte des impacts cumulatifs des activités.
Lorsqu’un permis de la LEP ou un permis de pêche délivré en vertu de la Loi sur les pêches ou une autorisation faisant office de permis de la LEP est délivré, une explication de la raison pour laquelle il a été délivré doit être publiée dans le Registre public de la LEP. Si l'activité est jugée redondante ou trop nuisible, le permis ou l'autorisation peut être modifié ou révoqué.
Pour les travaux, entreprises ou activités liés à des projets de développement, le ministre doit tenir compte d'un certain nombre de facteurs avant de décider de délivrer ou non l'autorisation en vertu de la Loi sur les pêches, tels que : les objectifs de gestion des pêches, les mesures et les normes en place afin d'éviter ou d'atténuer l'étendue des dommages, les effets cumulatifs, les connaissances autochtones et la question de savoir si la compensation donne la priorité à la restauration de l'habitat dégradé. Les exigences en matière d’information et les délais sont précisés dans les autorisations concernant le poisson et le Règlement sur l'habitat du poisson.
Pour les activités de recherche, les conditions préalables à l’approbation varient en fonction de la demande. Le MPO exige que tous les titulaires de permis puissent également obtenir une certification auprès du Canadian Council on Animal Care (CCAC) (Conseil canadien de protection des animaux), une organisation nationale qui exige que le traitement des animaux et les soins prodigués soient faits de façon appropriée et éthique lors des activités scientifiques et récréatives. Le CCAC prévoit des normes, des lignes directrices et un examen régulier par les pairs du Conseil canadien de protection des animaux. Le processus de certification des titulaires de permis implique une évaluation du programme d’éthique et de soins aux animaux de l’établissement, de l’efficacité de leur comité de soins aux animaux pour superviser le programme et la pertinence de leurs installations, des pratiques et des procédures pour les animaux.
En mars 2021, une soixantaine de cétacés étaient détenus en captivité au Canada. En juin 2019, une loi a été adoptée en vertu de la Loi sur les pêches (article 23) visant à éliminer progressivement la captivité des cétacés au Canada, le MPO élabore actuellement une série de politiques liée aux autorisations. La législation énonce des exigences strictes, notamment l'interdiction qu'un cétacé soit pêché à des fins d'exposition en captivité, l'interdiction qu' un nouveau cétacé captif soit importé au Canada, sauf dans des circonstances particulières qui pourraient bénéficier de manière significative au bien-être du cétacé ou à la conservation des espèces sauvages grâce à la recherche scientifique, et l'interdiction que de nouveaux cétacés soient ajoutés à ceux déjà en captivité au Canada par le biais de la reproduction.
Tous les aménagements existants de cétacés en captivité doivent être autorisés par un permis délivré à la personne ou à l'organisation concernée, notamment pour mener des recherches scientifiques ou à des fins sociales. Les conditions de ces permis visent à garantir que le programme de recherche est valable et utile, que des protocoles appropriés de soin et d'utilisation des animaux sont en place le cas échéant, que les chercheurs ont publié des articles scientifiques pertinents, et que les OBJECTIFS de toute recherche sur la reproduction des cétacés qui pourrait être autorisée sont de soutenir la conservation des stocks sauvages, et non de reconstituer les stocks de cétacés captifs.
Pour exporter des cétacés vivants répertoriés dans la Convention sur le commerce international des espèces de la faune et de la flore sauvages menacées d'extinction (CITES), un permis d'exportation continue d'être requis. Les permis d'exportation CITES pour les espèces aquatiques sont publiés par le MPO au nom d'Environnement et Changement climatique Canada (ECCC), qui est responsable de la CITES au Canada.
Développement de projets : examens et propositions
Les programmes liés aux mammifères marins résultant de l’examen de projets majeurs sont souvent mis en œuvre en collaboration avec d’autres agences gouvernementales et, si possible, alignés sur les programmes existants.
Le MPO apporte ses connaissances spécialisées sur les mammifères marins, leur habitat et les meilleures données scientifiques disponibles pour concevoir des mesures d'atténuation.
En vigueur depuis le 28 août 2019, les dispositions de la Loi sur les pêches définissent des mesures de protection pour tous les poissons, cela comprend les poissons et leurs habitats, les crustacés, les mollusques et les mammifères marins. En vertu de ces dispositions, les ouvrages, entreprises et activités qui entraînent une détérioration, une perturbation ou une destruction de l’habitat du poisson sont interdits. La mort de poissons résultant d'activités autres que la pêche est également interdite. À cela s'ajoute la LEP, qui offre une protection législative aux espèces en péril et à leurs habitats essentiels au Canada. Le MPO participe également aux évaluations fédérales des impacts avec d'autres ministères fédéraux pour garantir que les impacts potentiels des grands projets sur le poisson et son habitat, les mammifères marins et les espèces aquatiques en péril soient dûment pris en compte pendant la phase de planification.
Objectifs 3 - Liens pour plus d'informations
- Plans d'intervention localisée (PIL) de la GCC
- Port of Vancouver’s Enhancing Cetacean Habitat and Observation (ECHO) Program
- Be Whale Wise: Marine Wildlife Guidelines for Boaters and Viewers
- Politique relative aux permis de transport de mammifères marins
- Politique sur la pêche des espèces fourragères
- Depredation
Signaler :
- Signaler un incident ou une observation touchant un mammifère marin ou une tortue de mer
- Infractions liées à la pêche
Objectif 4 - Encourager
Soutenir la participation des Autochtones à la gestion des mammifères marins, notamment l’accès à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR).Priorités
- Envisager les opportunités de récolte à des fins ASR, une fois que les priorités de conservation ont été satisfaites.
- Utiliser les preuves scientifiques et les connaissances autochtones lors de la prise de décisions en matière de récolte de mammifères marins.
- Tenir compte de l'impact total de la pêcherie ; non seulement sur les espèces cibles, mais également sur les espèces non ciblées, les habitats des fonds marins et les écosystèmes dont ces espèces font partie.
Contexte
Les nations de l’ensemble de la côte ont une histoire féconde avec les mammifères marins. Le MPO reconnaît leur culture, leur langue, leurs traditions, leurs pratiques de récolte et les droits des peuples autochtones. Le MPO travaille avec les communautés pour leur garantir l'accès aux mammifères marins. Les discussions ont porté sur le partage des connaissances autochtones et de la science occidentale dans l'élaboration de plans de récolte, ainsi que sur la surveillance et l'intendance.
Gestion et récolte
La seule récolte de mammifères marins actuellement autorisée dans les eaux canadiennes du Pacifique est à des fins alimentaires, sociales et rituelles (ASR). En 1990, la Cour suprême du Canada a rendu un arrêt historique dans Décision Sparrow. La Cour suprême a statué que lorsqu'un groupe autochtone a le droit de pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles, il a la priorité, après la conservation, sur les autres utilisations de la ressource. Afin de faciliter la récolte, le MPO travaille avec les groupes autochtones pour déterminer les principaux intérêts.
Une partie des informations scientifiques comprend des calculs de prélèvement biologique potentiel (CPBP) – une mesure de gestion permettant de déterminer les dommages admissibles touchant un stock particulier de mammifères marins. Le CPBP est défini comme étant le nombre maximum d'animaux, sans compter les mortalités naturelles, qui peuvent être retirés d'un stock de mammifères marins tout en permettant à ce stock d'atteindre ou de maintenir durablement sa population optimale.
Principales considérations :
- Compréhension des intérêts/préférences des Autochtones.
- Connaissance autochtone.
- Informations scientifiques actuelles : abondance, répartition géographique, calculs d'éventuelles éliminations biologiques (CEBP).
- Lieu de récolte proposé.
- Moment de la récolte proposée.
- Dispositions relatives au contrôle des captures.
- Pratiques de récolte sans cruauté.
- Structure des populations.
- Exigences en termes de sécurité (sécurité alimentaire et sécurité de la récolte)
- Type d'engin.
En vertu de la LEP, les dommages admissibles sont considérés comme le nombre des dommages annuels, généralement exprimés en termes de mortalité, auxquels une population peut résister sans compromettre la survie et le rétablissement de l'espèce. Les dommages admissibles sont pris en compte lors de la délivrance de permis pour des activités affectant une espèce inscrite comme menacée, en voie de disparition ou disparue du pays en vertu de la LEP, ou toute partie de son habitat essentiel.
Objectif 5 - Maintenir
Trouver un équilibrer entre les secteurs économiques marins durables , la conservation et la protection des mammifères marins pour les Canadiens, les communautés autochtones et côtières.Priorités
- Favoriser les économies durables dans les communautés côtières qui créent un équilibrent entre les activités maritimes et la protection des mammifères marins.
- Promouvoir le transfert de technologie et l'innovation.
- Mettre en cohérence et soutenir les plans du MPO visant à élaborer un « cadre de gestion des plastiques dans l'océan et des engins fantômes ».
- Protéger les mammifères marins contre les impacts futurs des projets de développement sur les habitats, conformément aux dispositions sur la protection du poisson et de son habitat de la Loi sur les pêches et de la LEP.
Contexte
Un thème récurrent en matière de gestion est que nos océans et nos ressources marines doivent être en bonne santé pour soutenir une économie bleue prospère, tout en continuant à soutenir les industries qui dépendent traditionnellement de l’océan et de ses ressources.
Le MPO est conscient que les océans fournissent des emplois et font partie intégrante de la culture et de l'identité de nombreux Canadiens. Nous soutenons le développement d'opportunités économiques qui encouragent une gestion responsable de l'océan dans le but de conserver et maintenir les populations de mammifères marins dans les eaux du Pacifique. Le Canada a réalisé des investissements sans précédents dans les innovations marines pour la durabilité et la protection des océans. Cela a permis de développer des communautés côtières plus résilientes, des côtes plus propres, des partenariats plus solides avec les communautés autochtones et de créer des opportunités d'emploi et de croissance économique.
Ces OBJECTIFS mettent en valeur certains des programmes de Pêches et Océans Canada qui soutiennent activement la durabilité de la croissance économique et l'atténuation des menaces et d'éventuels impacts sur divers secteurs des activités maritimes dans la région du Pacifique, notamment : l'observation des mammifères marins, l'observation commerciale des baleines, la capture commerciale de la faune, les projets de pêche récréative, d’aquaculture et de développement du milieu marin..
Soutenir les pêches canadiennes d'exportation en vertu de la Loi sur la protection des mammifères marins
Les États-Unis est le principal marché du poisson et des fruits de mer du Canada, avec des exportations vers les États-Unis totalisant 4,3 milliards de dollars en 2017. En 2016, les États-Unis ont publié de nouvelles dispositions d'importation en vertu de la Marine Mammal Protection Act (MMPA) concernant la réduction des prises accessoires de mammifères marins lors de la pêche commerciale étrangère.
Tous les quatre ans, les États-Unis publient des informations sur toutes les pêcheries qui exportent vers les États-Unis dans la Liste des pêcheries étrangères. Après le 1er janvier 2022, un pays pratiquant la pêche avec l’intention d’exporter du poisson et des produits de la pêche vers les États-Unis doit demander à la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) des États-Unis un constat de comparabilité pour chacune de ses pêches commerciales répertoriées dans la liste des pêches étrangères.
Pour qu'un pays pratiquant la pêche reçoive un constat de comparabilité pour une pêche, les dispositions américaines de la Marine Mammal Protection Act (MMPA) sur l'importation exigent que le pays pratiquant la pêche démontre :
- que la mortalité intentionnelle ou les blessures graves infligées aux mammifères marins au cours des opérations de pêche commerciale soient interdites ; et
- que la mise en œuvre d'un programme de réglementation soit comparable en efficacité à celui des États-Unis et comprennent les estimations de prises accessoires provenant des programmes d’observation en mer et les mesures de gestion et d’atténuation.
Les pêches sont classées par les États-Unis, en fonction de la fréquence de leurs prises accessoires de mammifères marins, comme pêches « exemptées » ou « exportations ». Les pêches exemptées sont des pêches où il est peu probable que des mammifères marins soient capturés accidentellement et qui sont dispensées de mettre en place un programme de réglementation. Les pêches d'exportation sont les pêches présentant une probabilité plus que faible de captures accessoires de mammifères marins ou ayant des informations insuffisantes disponibles sur les interactions avec les mammifères marins.
Le MPO travaille en étroite collaboration avec l'industrie de la pêche commerciale de capture sauvage et d'autres intervenants pour faciliter le processus dans le cadre de ces nouvelles exigences réglementaires aux États-Unis. Il s'agit des profils de développement pour chaque pêche exportée vers les États-Unis et des informations relatives aux programmes actuels de surveillance des mammifères marins, des exigences en matière de déclaration et de mesures visant à atténuer le risque de prises accessoires de mammifères marins.
Les engins fantômes représentent un danger pour la navigation et sont souvent mortels pour les poissons, les mammifères marins et les autres espèces marines, ils se dégradent également en micro-plastiques, l’une des plus grandes menaces pour nos océans..
Engins fantômes
Les engins fantômes font référence à tout équipement de pêche ou détritus liés à la pêche qui ont été abandonnés, perdus ou jetés d'une quelconque manière. Ce sont les objets les plus nocifs et les plus mortels qui se trouvent dans les océans.
Les pêcheurs font preuve d’un engagement soutenu envers la protection de nos océans et la réduction des interactions des engins de pêche avec les mammifères marins. Les pêcheurs et leurs organisations respectives sont des partenaires essentiels pour récupérer et réduire le nombre d'engins fantômes, pour signaler les interactions entre les mammifères marins et les engins de pêche (exigé en vertu de l'article 39 du Règlement sur les mammifères marins – voir la page 39 pour plus d'informations) et pour prendre des mesures dans le but de protéger les baleines grâce à l'innovation en matière d'engins de pêche.
En février 2020, le MPO a organisé un sommet international sur l'innovation en matière d'équipement pour explorer davantage l'innovation concernant l'équipement et les possibilités de diminuer les enchevêtrements. En 2021, le MPO a travaillé sur des projets pilotes menés par l'industrie dans l'est du Canada pour tester l'application de nouvelles technologie comme les engins sans corde. De telles initiatives pourraient contribuer à réduire davantage la quantité de corde dans l’eau et, par conséquent, à réduire le risque d’enchevêtrement des baleines à l’avenir.
Le Canada a conscience de la menace que représentent les engins fantômes dans nos eaux et partout dans le monde. Nous avons identifié ce problème comme étant d'une importance nationale. Nous nous engageons à prendre des mesures concrètes pour soutenir la prévention, la récupération et l’élimination responsable des engins fantômes en collaborant avec de nombreux groupes, notamment des groupes autochtones, des pêcheurs, des organisations non gouvernementales environnementales et des communautés côtières. À l'échelle nationale, depuis 2020, 26,7 millions de dollars de financement ont été distribués pour soutenir 91 projets.
Le MPO a également créé le programme Fonds de contribution aux solutions de pêches durables et d'aide à l'élimination des engins fantômes de 16,3 millions de dollars. Avec l'aide des groupes autochtones, des pêcheurs, de l'industrie aquacole, des organisations à but non lucratif et des communautés, ce programme prend des mesures concrètes pour soutenir la prévention, la récupération et l'élimination responsable des engins fantômes. Ce programme aidera également les pêcheurs à acquérir de nouvelles technologies de pêche afin de réduire les pertes d’engins.
Le MPO travaille avec l'industrie pour entreprendre des initiatives d'élimination d'engins fantômes dans plusieurs juridictions. En 2020, la déclaration des engins de pêche perdus ou récupérés est devenue une condition obligatoire des permis pour toutes les pêches commerciales.
Lien pour plus d'informations : Formulaire de déclaration en ligne de perte et de récupération d'engin.
Travailler ensemble pour récupérer et recycler les engins fantômes
En 2020, un nouveau dépôt de recyclage spécialement conçu pour les déchets plastiques des océans, notamment les engins de pêche en fin de vie, a été construit à Ucluelet, en Colombie-Britannique. Désormais opérationnel, ce dépôt transforme le plastique provenant d'équipements fantômes en granulés qui seront utilisés dans la fabrication de produits plastiques recyclés, notamment des kayaks. Des possibilités de recyclage des engins de pêche sont également en cours de développement à Powell River et dans le détroit de Nootka en Colombie-Britannique. Pêches et Océans Canada s'est associé à la Coastal Restoration Society et aux Premières Nations locales pour supprimer les sites de conchyliculture abandonnés sur l'île de Vancouver.
Pour plus d'informations, lien Youtube : Nootka Sound ghost gear cleanup project
Observation des mammifères marins et des baleines
À l'issue d'un accord pérenne sur l'observation des baleines avec le ministre des Transports et de l'Infrastructure de la C.-B., les entreprises ne doivent pas proposer ou promouvoir intentionnellement des sorties en mer pour observer les épaulards résidents du Sud.
L'observation des mammifères marins et des baleines est pratiquée à des fins récréatives et constitue une activité écotouristique importante dans la région du Pacifique. Elle peut contribuer à sensibiliser le public à l'importance des mammifères marins. L'observation de tous les mammifères marins est soumise aux dispositions du Règlement sur les mammifères marins appliquées en vertu de la Loi sur les pêches.
La réglementation exige que toute activité d'observation de baleines ou de mammifères marins évite de les perturber et que les bateaux maintiennent les distances d'approche minimales suivantes pour protéger ces animaux des perturbations causées par les humains :
- une distance d'approche minimale de 100 mètres (m) des baleines, marsouins et dauphins, ou de 200 m s'ils sont en position de repos ou avec leur petit, dans toutes les eaux canadiennes ;
- une distance d'approche minimale de 200 m de tous les épaulards dans les eaux de pêche canadiennes de l'océan Pacifique
- une distance d'approche minimal de 400 m de tous les épaulards dans les eaux côtières du sud de la Colombie-Britannique,conformément à l'Arrêté d'urgence adopté en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada. Cette distance d'approche s'applique à tous les bateaux, elle est révisée chaque année en vertu des dispositions de l'arrêté d'urgence.
Dans le cadre des dispositions de l'arrêté d'urgence, il existe une exception pour les entreprises commerciales d'observation des baleines et d'écotourisme agréées.
Le ministre peut délivrer une autorisation à une entreprise commerciale d'observation des baleines permettant de laisser observer un épaulard non-résident à un distance comprise entre 200 m et 400 m dans les zones où l’Arrêté d’urgence s’applique. Cette autorisation est donnée dans le cadre de l'Accord pour l'observation des baleines à long terme dans lequel les entreprises doivent conclure un accord avec le ministre des Transports qui les engage à ne pas offrir ou promouvoir intentionnellement des excursions basées sur l'observation des épaulards résidents du Sud.
Si une entreprise ne respecte pas l'un des paramètres énoncés dans l'Accord pour l'observation des baleines à long terme, elle peut être soumise à une sanction administrative pécuniaire et/ou à une éventuelle révocation ou suspension de son autorisation d'exercer.
Un certain nombre de mesures peuvent être prises volontairement par tous les exploitants de navires, les pagayeurs et les observateurs pour être Be Whale Wise (prudent avec les baleines) et réduire les perturbations affectant tous les mammifères marins, notamment :
- ralentir à 7 nœuds ou moins à moins de 1 000 m du mammifère marin le plus proche ;
- éteindre les échosondeurs et les détecteurs de poissons en présence de mammifères marins et lorsqu'ils ne sont pas utilisés ;
- placer le moteur au ralenti et permettre aux animaux de passer si le navire n'est pas en conformité avec les réglementations sur la distance d'approche ;
- limiter la durée d'observation à 30 minutes ou moins ;
- vérifier les cartes marines pour connaître l'emplacement des diverses zones protégées et interdite.
Observer et protéger les baleines dans nos eaux
L'observation des baleines et d'autres mammifères marins dans leur environnement naturel donne aux Canadiens l'occasion de mieux apprécier ces magnifiques animaux. Mais lorsque les humains s'approchent trop près de la faune dans son habitat ils risquent de la perturber, voire de lui nuire. Les lois et règlements du Canada, ainsi que les meilleures pratiques, contribuent à garantir que nos baleines et nos mammifères marins peuvent toujours être appréciés, mais en respectant une distance de sécurité.
Lien pour plus d'informations : Regarder et observer les mammifères marins.
Message de conclusion : Concrétiser les OBJECTIFS en action au fil du temps
La conservation et la protection des mammifères marins ainsi que le soutien de la pérennité des activités marines est une responsabilité partagée par tous dans cette région. La gestion des mammifères marins est un processus continu visant à faire respecter les OBJECTIFS de ce cadre en conservant les mammifères marins pour les générations actuelles et futures.
Ressources et outils supplémentaires
Les ressources et les outils fournis tout au long de ce cadre intégrateur visent à guider un processus de gestion adaptative dans le contexte des cinq objectifs de gestion axés sur les actions décrites. Bien qu'il s'agisse d'une initiative dirigée par le MPO pour la Colombie-Britannique, ce travail est rendu possible, et continuera de l'être, grâce aux efforts de collaboration avec d'autres organismes gouvernementaux, les groupes autochtones, les intervenants et les communautés côtières.
Annexe I : Espèces de mammifères marins en Colombie -Britannique
Ordre : Cétacé
Cétacés : baleines, dauphins et marsouins
Les baleines à fanons (Mysticètes) font partie des plus gros animaux de la planète. Les plaques de fanons caractéristiques et les évents appariés aident à distinguer les baleines à fanons des baleines à dents. Les baleines à fanons doivent leur nom aux longues plaques de fanons qui pendent en rangée (comme les dents d'un peigne) à leur mâchoire supérieure. Les fanons sont solides et flexibles ; ils sont constitués d’une protéine semblable aux ongles humains. Les fanons sont larges à la base (ligne des gencives) et se rétrécissent en une frange qui forme un rideau ou un tapis à l’intérieur de la bouche de la baleine
Les baleines à fanons filtrent d'énormes volumes d'eau océanique à travers leurs fanons pour capturer de la nourriture et consommer des tonnes de krill, d'autres zooplanctons, crustacés et petits poissons.5 Les documents de planification du rétablissement (c'est-à-dire les stratégies de rétablissement, les plans d'action et les plans de gestion) pour les espèces de la région du Pacifique inscrites à l'annexe 1 de la LEP peuvent être consultés à l'adresse suivante : https://www.canada.ca /en/environment-climate-change/services/Espèces-risk-public-registry.html
Tableau 1: Baleines à fanons. Liste complète des espèces identifiées dans les eaux canadiennes du Pacifique
| Espèces | Identification (images pas à l'échelle) |
Population /Unité désignable (UD) | Statut à ce jour Sur la liste en vertu de l'Annexe 1 de la LEP | Statut COSEPAC à la dernière évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Baleine bleue |  |
Population du Pacifique | En péril Sur la liste : 2005 |
En péril Évaluée en : 2012 |
| Baleine franche du Pacifique Nord |  |
Population du Pacifique Nord | En péril Sur la liste : 2006 |
En péril Évaluée en : 2015 |
| Rorqual commun |  |
Population du Pacifique | Menacée Sur la liste : 2006 |
Très préoccupante Évaluée en : 2019 |
| Rorqual boréal |  |
Population du Pacifique | En péril Sur la liste : 2005 |
En péril Évaluée en : 2013 |
| Baleine grise |  |
Population du Pacifique Nord Remarque : Après sa division en deux unités désignables (UD) 6, la structure de cette population a été réévaluée par le COSEPAC en 2017, avec l'ajout d'une troisième UD pour la population du Pacifique occidental, jusqu'alors inconnue du COSEPAC qui apparait dans les eaux canadiennes du Pacifique. | Très préoccupante Sur la liste : 2005 |
Non-active Évaluée en : 2017 |
| Population migratrice du Pacifique Nord | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 2017 |
||
| Population du groupe d’alimentation de la côte Pacifique | À l’étude pour figurer sur la liste | En péril Évaluée en : 2017 |
||
| Population du Pacifique Ouest | À l’étude pour figurer sur la liste | En péril Évaluée en : 2017 |
||
| Baleine à bosse |  |
Population du Pacifique Nord | Très préoccupante Sur la liste : 2017 |
Très préoccupante Évaluée en : 2022 |
| Rorquals à petit museau communs (sous-espèce du Pacifique Nord) |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 2006 |
Baleines à dents (Odontocètes). Près de 90 % des espèces de cétacés sont des baleines à dents. La plupart des baleines à dents sont de petits dauphins et des marsouins. Cependant, il existe quelques grandes baleines à dents dont le cachalot qui atteint 18,30 mètres (60 pieds) de longueur. La présence de dents et d'un évent externe distingue les baleines à dents des baleines à fanons. De plus, les baleines à dents utilisent l'écholocation (c'est-à-dire le biosonar) pour localiser la nourriture, s'orienter et "voir" leur environnement.
Tableau 2: Baleines à dents - Liste complète des espèces identifiées au Canada
| Espèces | Identification (images pas à l'échelle) |
Population /Unité désignable (UD) | Statut à ce jour Sur la liste en vertu de l'Annexe 1 de la LEP | Statut COSEPAC à la dernière évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Cachalot |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1996 |
| Globicéphale tropical |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en :: 1993 |
| Baleine à bec de Baird |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1992 |
| Baleine à bec de Cuvie |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1990 |
| Baleine à bec de Hubb |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1989 |
| Baleine à bec de Stejneger |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1989 |
| Dauphin à flancs blancs du Pacifique |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1990 |
| Le dauphin de Risso |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1990 |
| Épaulard |  |
Population au large du Nord-Est du Pacifique | Menacée Sur la liste : 2003 |
Menacée Évaluée en : 2008 |
| Résident du Nord : population au Nord-Est du Pacifique | Menacée Sur la liste : 2003 |
Menacée Évaluée en : 2008 |
||
| Résident du Sud : population au Nord-Est du Pacifique | Menacée Sur la liste : 2003 |
Menacée Évaluée en : 2008 |
||
| En transit : population au Nord-Est du Pacifique | Menacée Sur la liste : 2003 |
Menacée Évaluée en : 2008 |
||
| Faux épaulard | 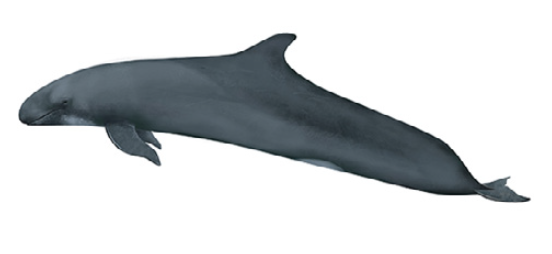 |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1990 |
| Marsouin commun |  |
Population du Pacifique | Très préoccupante Évaluée en : 2005 |
Très préoccupante Évaluée en : 2016 |
| Dauphin du Nord |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1990 |
| Marsouin de Dall |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1989 |
| Cachalot pygmé |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1994 |
| Cachalot nain |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1997 |
| Dauphin commun à long bec |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1993 |
| Dauphin commun à bec court | 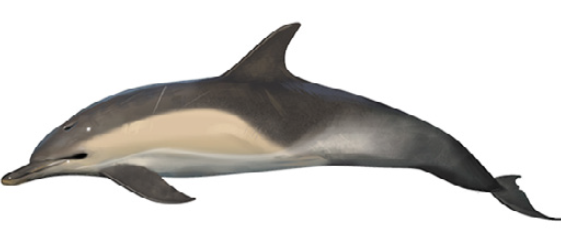 |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1991 |
| Dauphin rayé |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1993 |
Ordre : Carnivore
Pinnipèdes (Phoques et lions de mer)
Le mot pinnipède signifie nageoire et fait référence aux phoques, aux lions de mer et aux morses. Ces animaux vivent dans l'océan mais doivent venir sur terre pour certains processus vitaux (par exemple la reproduction). Il existe trois familles de pinnipèdes : les phocidés (vrais phoques, comprenant les éléphants de mer), les otariidés (phoques à oreilles et otaries) et les odobénidés (morses) (The Marine Mammal Center, s.d.).
Tableau 3: Pinnipèdes - Liste complète des espèces dans les eaux canadiennes du Pacifique
| Espèces | Identification (images pas à l'échelle) |
Population /Unité désignable (UD) | Statut à ce jour Sur la liste en vertu de l'Annexe 1 de la LEP | Statut COSEPAC à la dernière évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Lion de mer de Steller |  |
Population du Pacifique Est | Très préoccupantes Évaluée en : 2005 |
Très préoccupantes Évaluée en : 2013 |
| Lion de mer de Californie |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1987 |
| Phoque commun |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1999 |
| Éléphant de mer du Nord |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Pas en péril Évaluée en : 1986 |
| Otarie du Nord à fourrure |  |
Population du Pacifique | Pas sur la liste | Menacée Évaluée en : 2022 |
Ordre: Carnivore
Mustélidés (Loutre de merde mer)
La loutre de mer est le membre le plus aquatique de la famille des Mustelidés (famille des belettes), elle s'échoue rarement, en particulier dans les zones habitées par l'homme. Le corps de la loutre de mer est entièrement recouvert d’une fourrure épaisse, à l’exception des yeux, du nez, de l’intérieur des petites oreillettes et des coussinets des pattes. De grands groupes se rassemblent en une formation connue sous le nom de radeau. Après avoir disparu de la chasse commerciale aux 19e et 20e siècles, les loutres de mer ont été réintroduites en Colombie-Britannique à la fin des années 1960 et au début des années 1970. Quatre-vingt-neuf animaux ont été capturés au large de l'île d'Amchitka et dans le détroit de Prince William en Alaska, puis transférés à trois reprises dans la baie de Checleset sur la côte ouest de l'île de Vancouver : 29 loutres en 1969, 14 en 1970, et 46 en 1972. Depuis lors, la population a connu une croissance remarquable qui s'élevait à environ 8 000 loutres en 2017.
Tableau 4 : Mustélidés. Liste complète des espèces dans les eaux canadiennes du Pacifique
| Espèce | Identification (Image pas à l’échelle) | Population / Unité désignable (UD) | Statut selon la LEP à ce jour Sur la liste en vertu de l’Annexe 1 | Statut du COSEPAC selon la dernière évaluation |
|---|---|---|---|---|
| Loutre de mer |  |
Population du Pacifique | Très préoccupante Évaluée en : 2003 |
Très préoccupante Évaluée en : 2022 |
Annexe 2 : références
- Burnham RE, Vagle S, O’Neill C and Trounce K (2021). The Efficacy of Management Measures to Reduce Vessel Noise in Critical Habitat of Southern Resident Killer Whales in the Salish Sea. Front. Mar. Sci. 8:664691. doi : 10.3389/fmars.2021.664691
- Pêches et Océan Canada. (3 mars, 2009). Cadre décisionnel pour les pêches intégrant l’approche de précaution. Extrait provenant du gouvernement du Canada : https://www.dfo-mpo.gc.ca/reports-rapports/regs/sff-cpd/precaution-fra.htm
- Ford, J. K. (2014). Royal BC Museum Handbook: Marine Mammals of British Columbia (Vol. 6). Victoria: Royal BC Museum.
- Gregr, E. J., Calambokidis, L., Convey, L., Ford, J. K., Perry, R. I., Spaven, L., & Zacharias, M. (2005). Proposed Recovery Strategy for Blue, Fin, and Sei Whales (Balaenoptera musculus, B. physalus, B. borealis) in Pacific Canadian waters. Nanaimo: Fisheries and Oceans Canada. NOAA. (n.d.). Whales. Extrait de https://publications.gc.ca/site/eng/293869/publication.html
- Centre des mammifères marins. (n.d.). Pinnipèdes : Phoques, otaries et morses. Extrait du Centre des mammifères marins :https://www.marinemammalcenter.org/animal-care/learn-about-marine-mammals/pinnipeds
- Laist et al. (2001). Collisions between ships and whales. Marine Mammal Science 17(1):35-75
- Jarvela Rosenberger, A.L., MacDuffee, M., Rosenberger, A.G.J. et al. Oil Spills and Marine Mammals in British Columbia, Canada: Development and Application of a Risk-Based Conceptual Framework. Arch Environ Contam Toxicol 73, 131–153 (2017). https://doi.org/10.1007/s00244-017-0408-7
Annexe 3: glossaire des acronymes
| Acronyme | Traduction |
|---|---|
| APC | Agence Parcs Canada |
| ASR | Alimentaires sociales et rituelles |
| C et P | Conservation et protection |
| CA | Connaissances autochtones |
| CCCCEP | Conseil canadien de la Couronne pour la conservation des espèces en péril |
| CCIEPGGS | Convention sur le commerce international des espèces en péril de la faune et de la flore sauvages |
| CCPA | Conseil canadien sur la protection des animaux |
| CET | Connaissance écologique traditionnelle |
| CIE | Coordonnateurs des incidents environnementaux |
| CIMM | Conseil sur l'intendance du milieu marin |
| CNAEM | Conseil national autochtone sur les espèces menacées |
| CNAEM | Convention de NU sur la diversité biologique |
| CNUDB | Convention des Nations-Unis sur le droit de la mer |
| CNUDM | Convention des Nations-Unis sur le droit de la mer |
| CNUE | Centre national des urgences environnementales |
| COSEPAC | Comité sur la situation des espèces en péril au Canada |
| CTA | Connaissances traditionnelles autochtones |
| EAN | Étiquette acoustique numérique |
| EAN | Efflorescence d'algues nuisibles |
| ECCC | Environnement et Changements climatiques Canada |
| EIRPM | Enquête internationale de la région du Pacifique sur la mégafaune |
| ERS | Épaulard résident du Sud |
| GCC | Garde côtière canadienne |
| LDQE | Lignes directrices pour la qualité de l'environnement |
| LEP | Loi sur les espèces en péril |
| LPE | Liste des pêches étrangères |
| LPMM | Loi sur la protection des mammifères marins |
| MDN | Ministère de la Défense nationale |
| MPO | Ministère de Pêches et Océans Canada |
| NOAA | National Oceanic and Atmospheric Administration |
| OIPABP | Outils pour l'inventaire des polluants affectant les baleines et leur proies |
| ONGE | Organisation non gouvernementale environnementale |
| PA et ANC | Partenaires autochtones et Affaires du Nord du Canada |
| PAHOC | Programme d'amélioration de l'habitat et de l'observation des cétacés |
| PEM | Planification de l'espace marin |
| PGPC | Plan de gestion des produits chimiques |
| PCIE | Planification de la coordination des interventions environnementales |
| POP | Polluants organiques persistants |
| PPPH | Programme de protection du poisson et de son habitat |
| PRC | Programme de recherche sur les cétacés |
| PZI | Plans des zones d'intervention |
| QEM | Qualité de l'environnement marin |
| RBP | Retrait biologique potentiel |
| RDAAD | Reconnaissance des droits autochtones et de l'auto-détermination |
| RLB | Réseau de localisation de baleine |
| RPPCA | Règlementations sur les permis de pêche communautaire autochtone |
| SASB | Système d'alerte et de signalement de baleines |
| SCCS | Secrétariat canadien de consultation scientifique |
| SCF | Service canadien de la faune |
| SIA | Systèmes d'identification automatiques |
| UD | Unité désignable |
| ZEE | Zone économique exclusive |
| ZMP | Zone marine protégée |
Notification légale
Le cadre et les mesures de gestion peuvent être modifiés à tout moment et n’entravent pas les pouvoirs discrétionnaires du Ministre prévus dans la Loi sur les pêches. Le ministre peut, pour des raisons de conservation ou pour toute autre raison valable, modifier toute disposition du cadre conformément aux pouvoirs accordés en vertu de la Loi sur les pêches. Ce cadre n’est pas une exigence prescrite en vertu de la Loi sur les pêches, la Loi sur les espèces en péril ou tout autre législation fédérale mentionnée dans ce document. Il vise plutôt à servir de document cadre pour tous les mammifères marins des eaux canadiennes du Pacifique qui définit le contexte dans lequel les mesures de gestion sont envisagées. Lorsque le MPO est responsable de la mise en oeuvre des obligations en vertu des accords sur les revendications territoriales, le cadre sera mis en oeuvre d’une manière conforme à ces obligations. Dans le cas où le cadre serait incompatible avec les obligations découlant des accords sur les revendications territoriales, les dispositions des accords sur les revendications territoriales prévaudront dans la mesure de l’incompatibilité.
©Sa Majesté le Roi du chef du Canada, représentée par le ministre des Pêches et des Océans, 2024
N° de cat. Fs144-71/2024F-PDF
ISBN 978-0-660-70139-4
- Date de modification: